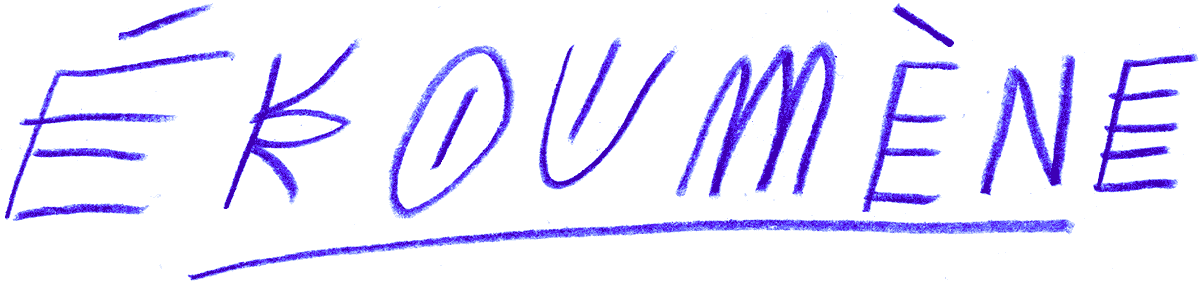Une manière d’habiter en commun : l’expérience d’Ékoumène. [Réflexions sur la diffusion des communs / 1]1
Texte publié dans la revue Agencements. Recherches et pratiques sociales en expérimentation, n°6, p.137-167
Guillaume Sabin (Arènes UMR 6051, Rennes)
Pierre Servain (Labers UR 3149, Brest)
Habitants d’Ékoumène
La notion des « communs » est dans toutes les bouches. Elle annonce pour les uns une nouvelle révolution pour le XXIe sièclei, elle est pour les autres du registre des « bonnes pratiques » à ne pas manquerii. Étonnamment, d’un pôle à l’autre, la pratique des communs semble aller de soi : soit qu’elle relève d’une logique mondiale amenée à se généraliser et déjà en gestation, soit de gestes simples et consensuels servant de synthèse heureuse située entre un capitalisme excessif et une logique étatique bien trop centralisatrice et donc peu démocratique.
Cette manière de parler des communs explique son succès discursif : elle séduit aussi bien les univers militants en recherche d’alternatives à un système socio-économique dévastateur des ressources environnementales et humaines que les lieux de décision des politiques publiques. Les collectivités locales, et particulièrement les métropoles, se saisissent ainsi de cette notion pour en faire quelque chose de facilement attrayant et participant du kit de survie pour modèles de gestion publique en perte de légitimité (avec d’autres notions passe-partout telle que démocratie contributive ou budget participatif). Les évènements sur ce thème se multiplient à grand renfort de communication.
Le risque est grand alors de vouloir évacuer toute dimension politique aux pratiques relevant des communs, et cette disparition pose au moins deux problèmes majeurs. D’une part, dans ces conditions d’évidences où les communs sont présentés comme des sortes de panacée, on se demande pourquoi ils ne sont pas généralisés à tous les espaces sociaux… Pourquoi le rêve de la maison individuelle, de la voiture à soi, du bonheur privé persiste-t-il avec tant de vigueur ? D’autre part, c’est occulter une caractéristique des communs dans la période qui est la nôtre : dans un contexte social qui s’agence autour des logiques de privatisation, les pratiques des communs sont nécessairement politiques, au sens où elles font surgir du neuf dans les actions humainesiii et de la polémique dans la manière de concevoir ces actionsiv. Cette dimension politique des communs explique aussi bien leur capacité à faire bouger des lignes que les difficultés rencontrées pour faire naître, développer et pérenniser ce type de pratique.
C’est à partir de notre expérience d’habitants d’un immeuble construit, géré et habité collectivement que nous souhaitons interroger de manière pratique et théorique ces « communs », et particulièrement la manière dont ils peuvent se diffuserv. C’est à partir de nos pratiques terre-à-terre et quotidiennes que se construit notre propos, et à partir de quelques éléments qu’il faut présenter dès maintenantvi. Le projet Ékoumène est de taille très modeste, il compte 6 logements, une dizaine d’adultes et autant d’enfants, mais il est le résultat d’un long travail collectif de sept années pour que l’immeuble sorte de terre, un long marathon, compliqué par le saut d’obstacles à répétition et la nécessité de rester groupé coûte que coûte ; l’installation de ce collectif d’habitant·es n’a rien non plus d’évident pour les voisin·es du quartier ; la construction d’un local associatif au pied de l’immeuble intrigue et fait jaser. Ces « communs » ne s’arrêtent pas à la construction d’un bâtiment, mais à l’agencement d’un certain type ou d’une certaine densité de relations sociales, et tout cela demande énergie et persévérance. Il semble que construire des communs, même modestement, n’ait rien de simplevii. Et, en tout cas, ne se fasse ni en apesanteur ni en milieu éthéré. Dans ces conditions, n’est-il pas un peu court d’en appeler aux communs pour qu’ils adviennent ?
Pour commencer cette discussion, précisons que nous entendons par communs une activité collective, une pratique d’autogouvernement qui transforme des biens, des services, des activités, des usages privés en pratiques communes issues d’un processus de délibération ; il s’agit d’un mouvement anti-privatisation se déployant dans un régime culturel qui s’érige autour de la figure du propriétaireviii. Ce contexte privatif n’est pas un décor dans lequel évoluent les pratiques des communs, il agit sur elles, les fait agir, ce qui explique le risque parfois encouru de construire des communs qui n’échappent pas eux-mêmes à cet horizon du paradis privé – et en premier lieu les projets autour de l’habitat, qui se situent toujours à la frontière du privé et du collectif, du propre et du commun, de l’intime et du marqueur social, de l’entre-soi et d’une volonté d’ouverture.
C’est dans ce contexte de tension, de luttes matérielles et symboliques, de construction de subjectivités collectives antagoniques que nous posons la question suivante : comment les communs peuvent-ils naître, se développer et perdurer ?
Ékoumène : présentation
« Voici la proposition d’un projet qui devrait susciter intérêt, désir et motivation : acheter collectivement un immeuble, pour sortir de la propriété privée et pour bien d’autres choses aussi… » : c’est par cette invitation adressée à quelques ami·es rapproché·es par des pratiques et engagements dans des associations d’éducation populaire que naît en 2006 le projet Ékoumène, qui se concrétise en 2014 par la construction à Brest d’un immeuble de 6 logements réunissant dix adultes et autant d’enfants. Durant ces années de gestation, la vie en commun est déjà monnaie courante pour la plupart des futur·es habitant·es : réunions, repas partagés, réflexions communes, jeux et moments collectifs pour les enfants, partage de voitures, garde d’enfants… Ékoumène s’agence autour de 3 dimensions discutées dès les prémices du projet et qui orientent à la fois le type de construction et la vie du groupe : une dimension anti-spéculative qui oblige à inventer un couplage original entre une société civile immobilière (Sci) et une association à but non-lucratif permettant ainsi de soustraire l’immeuble puis le local associatif à la spéculation immobilière ; une dimension démocratique qui se traduit notamment dans les statuts de la Sci par le dispositif « un·e associé·e = une voix », par une cogérance tournante et obligatoire étroitement limitée à la mise en œuvre des décisions prise par l’ensemble des associé·es ; une dimension écologique qui se traduit par le choix des matériaux de construction, la conception passive de l’édifice qui permet de se passer presque entièrement de chauffage, le recours à des énergies renouvelables, le projet en cours de centrale photovoltaïque, etc. L’image qui vient rapidement à l’évocation de l’immeuble Ékoumène est celle d’une grande maison, gérée collectivement, où les parties communes sont aussi habitées et soignées que les appartements, où les aménagements, l’organisation, les envies sont discutées collectivement tous les 15 jours lors d’une réunion d’habitant·es suivie d’un repas en commun. C’est l’effet perçu par les visiteurs, mais c’est aussi pour les habitant·es une manière de se soucier de tous les espaces, des problèmes rencontrés dans tel ou tel appartement (fuite d’eau, invasion de puces de plancher, défaut de conception…) et qui sont considérés comme le problème de toutes et tous.
L’installation dans l’immeuble, très attendue après plusieurs mois de travaux réalisés par le groupe d’habitant·es avec le soutien de près de 100 personnes (familles, réseaux d’amitié et associatif, inconnu·es arrivé·es par bouche-à-oreille…), n’est pourtant pas une révolution dans nos modes de vie. Celle-ci s’en trouve simplement renforcée et facilitée (descendre ou monter d’un étage pour retrouver des ami·es, demander un service, se dépanner) et les enfants y trouvent vite leur avantage (ne pas avoir à demander d’autorisation pour se rendre chez les copains ou bien sonder les foyers pour savoir ce qui se prépare comme repas, et s’inviter en fonction du menu). La période qui s’étend de notre installation dans l’immeuble, début 2015, à aujourd’hui, soit un peu plus de cinq années, permet de comprendre que les communs ne sont pas que ces aspects visibles des choses, mais bien une activité collective et féconde qui ne s’est pas arrêtée pendant la phase, dense, de travaux, d’installation puis d’aménagement.
L’association Ékoumène, créée dès 2008, permet d’intégrer la participation de non-habitant·es au projet. Elle est créée au départ pour donner une dimension collective au projet et lui offrir un cadre officiel, puis les statuts sont modifiés pour s’articuler à ceux de la Société civile immobilière Ékoumène. Les personnes qui s’y investissent (initialement ami·es, ami·es d’ami·es, familles, personnes issues de nos réseaux associatifs…), intéressées par la question d’un habitat différent et la possibilité d’y faire vivre un espace associatif et collectif, sont un soutien moral et physique durant toute la phase de conception et la construction de l’immeuble, période durant laquelle les obstacles se multiplient, et paraissent parfois aux futur·es habitant·es presque insurmontables. Dans cette période d’intense activité, signe que la dimension collective du projet ne s’arrête pas au groupe de futur·es habitant·es et à leur logement, les réunions, les temps de réflexion, les actions en vue de financer la construction d’un local associatif continuent.
Quelques mois plus tard, entrecoupé d’une pendaison de crémaillère de l’immeuble qui accueillera de très nombreuses personnes pendant 4 jours et 3 nuits, le chantier du local associatif est lancé sur une partie du terrain qui accueille déjà l’immeuble. La plaquette de la campagne d’appel à dons indique : « Un local pour faire vivre le collectif ! L’association Ékoumène, nouvellement installée dans le quartier des Quatre Moulins, à Brest, va construire cet été un local de 50m2 qu’elle souhaite ouvert à nos désirs et à nos résistances. Le permis de construire est accepté, la dalle de béton est déjà coulée. Un appel à souscription est lancé, 20 000 euros ont déjà été récoltés, il en manque autant pour voir ce local sortir de terre dans le cadre d’un chantier collectif. » Il faut deux années pour que ce local soit entièrement fini et aménagé, puis inauguré et nommé Le Cinquième (en référence aux quatre niveaux de l’immeuble et au nom du quartier, les Quatre Moulins), et qu’il commence à accueillir ses premier·es occupant·es et ses premières activités. La deuxième partie de cet article revient en détail sur cette dimension associative du projet, mais son évocation permet de donner une juste mesure de cette vie collective assez intense, où la vie en commun concerne à la fois celle des habitant·es de l’immeuble (vie quotidienne, travaux d’aménagements de la cour, de l’atelier, des buanderies…), et celle plus large et pas moins active de l’association et du Cinquième (rencontres, chantiers collectifs, réunions publiques…). C’est dans le cadre de cette vie-là que s’insèrent nos pratiques des communs.
Sortir de la propriété privée : le versant juridique
En tant qu’habitant·es, nous n’utilisons pas formellement le concept des « communs », mais celui-ci se décline sous les mots de « collectif », de « mutualisation », de « mise en partage » et les pratiques quotidiennes que ceux ci-recouvrent. En 2018, lors d’une assemblée générale de la Sci Ékoumène sur le thème de la mise en commun des choses matérielles et immatérielles partagées dans et autour de l’immeuble, les murs du Cinquième se remplissent de grandes feuilles qui font apparaître tout ce qui est partagé, mutualisé ou mis en commun à Ékoumène : une cour, un jardin, des paliers, un atelier, des buanderies, des machines à laver, des ustensiles de cuisine, des aspirateurs, des outils de bricolage et de jardinage, des voitures (avec un planning affiché en rez-de-chaussée), des jeux d’enfants, des vélos, des livres, revues et films (disponibles sur les paliers ou au Cinquième), une forme d’éducation des enfants (qu’on le veuille ou non !), des chantiers et des ménages collectifs, les abonnements d’eau, de gaz, d’électricité, d’Internet, un local associatif, des actions, des projets, des discussions, des compétences, des coups de mains, des repas, des apéros, des fêtes, des spectacles d’enfants, des amitiés, etc. Ce brainstorming permet de multiplier les exemples, les feuilles se remplissent, à la surprise même des personnes concernées. Cette idée des communs, nous la mettons en pratique dès le départ, à partir d’une critique de la propriété privée et une tentative de son dépassement.
Les statuts juridiques permettent de constituer une propriété collective du foncier et du bien immobilier sous la forme d’un couplage entre une société civile immobilière (Sci) et une association. Chacun·e des habitant·es, propriétaire d’une part sociale, peut occuper un logement « à titre gratuit », en échange d’un apport en compte-courant d’associé·e qui finance le logement et constitue une sorte de prêt à la Sci et que celle-ci devra rembourser au moment du départ d’un ou une habitant·e. Chaque ménage a l’usage de son logement, mais il ne peut pas le vendre (il ne lui appartient pas) ni le modifier substantiellement sans passer par une délibération collective de l’ensemble des associé·es (habitant·es et représentant·es de l’association Ékoumène). Pour renforcer cette dimension anti-spéculative, le capital social de la Sci est détenu à 99% par l’association, chaque habitant·e n’en possédant que 0,1%.
Cette complexification de la propriété est signe du passage d’une propriété pleine et entière à une logique des communs où droits et usages mélangent des dimensions individuelles et collectives, limitent les niveaux d’appropriation et contraignent à des espaces de délibérations collectivesix. Si, selon l’article 554 du Code civil, « la propriété est les droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue », ce type de montage juridique et les conséquences qu’il a sur la gestion du bien et la manière d’y vivre permet d’en sortirx.
Cette complexification de la propriété qui introduit la possibilité et l’obligation de délibérer sur la gestion, l’usage, la transformation, la cession du bien est un des éléments que l’on retrouve dans toutes les pratiques des communs, y compris les plus anciennes et les plus éloignéesxi. Elle permet à Ékoumène de sortir le bien immobilier du marché, et a fortiori de la spéculation immobilière : un·e habitant·e qui quitte son logement récupère ses apports initiaux, éventuellement indexés à l’évolution du coût de la vie établi par l’Insee, mais son apport initial – déconnecté de la part sociale – ne pourra pas être réévalué en fonction du prix du marché immobilier. Ce mécanisme permet de valoriser l’utilité sociale du bien au détriment d’une logique individuelle et marchande.
Il faut d’ores et déjà préciser que la mise en œuvre de ce type de statuts n’a rien de simple, qu’elle ne suit pas une quelconque pente naturelle qui serait celle de l’air du temps ou de l’évidence du moment. Il faut plus d’un an de séances hebdomadaires de travail à la commission Statuts d’Ékoumène pour inventer des statuts qui répondent aux trois enjeux principaux fixés par le groupe (anti-spéculation, démocratie, écologie)xii. Une fois les statuts vérifiés d’un point de vue légal et entérinés par le groupe, il faut ensuite expliquer la démarche à notre notaire (qui ne s’était pas estimé compétent sur ce genre de montage), trouver une banque qui accepte de financer des prêts immobiliers dans ce cadre statutaire original et ne reposant pas sur la propriété individuelle des emprunteurs (une seule finira par accepter, ce qui signifie purement et simplement que le projet aurait très bien pu ne pas voir le jour). Il faudra ensuite, au moment de la viabilisation du terrain sur lequel sera construit l’immeuble puis Le Cinquième, expliquer à de multiples reprises aux entreprises qui assurent le raccordement des réseaux d’eau et d’assainissement, d’électricité, de gaz, etc. la nature et la spécificité de notre organisation, qui non seulement fonctionne sur le mode de l’autogestion et donc de l’autopromotion, mais également sur le brouillage des formes statutaires classiques, à savoir locataire ou propriétaire. Un de nos slogans au moment de la diffusion du projet était d’ailleurs : « Ni propriétaires, ni locataires »xiii. Signe supplémentaire que ces choix des communs ne vont pas de soi, certains membres de l’association Ékoumène, pourtant intéressés par le fait d’habiter autrement, s’inquiètent des choix effectués par les futur·es habitant·es et des risques qu’ils et elles prendraient pour leur avenir individuel, par exemple en ne pouvant pas revaloriser le bien au moment de leur départ. Développer des pratiques des communs, c’est aujourd’hui, dans ce premier quart de XXIe siècle, aller à contre-courant – et le groupe s’y est parfois épuisé.
Néanmoins, à cinq ans de distance de notre installation, nos choix sont confortés par l’organisation quotidienne qu’a permis ce couplage Sci-association, notamment parce qu’il permet, via l’association Ékoumène, de faire rentrer de nouvelles personnes dans la boucle de cette pratique des communs. Un travail de diffusion de ces statuts est réalisé depuis leur mise en œuvre (affiches, participations à des rencontres, site internet : www.ekoumene.infini.fr) et nous avons répondu aux questions et échangé avec plusieurs dizaines de groupes en phase de construction de projet d’habitat collectif. Signes que si expérimenter les communs c’est aller à contre-courant, cela n’empêche pas qu’ils inspirent et qu’ils se diffusent – nous reviendrons spécifiquement sur cette question dans la seconde partie, à paraître, de cet article.
Sortir de la propriété : le versant pratique et quotidien
Mais sortir de la propriété n’est pas qu’une question juridique, car celle-ci n’est pas qu’un terme de droit, elle est aussi une idée et une pratique sociale solidement entérinée depuis une période qu’il est d’usage de faire remonter au droit romain. Sortir de la propriété signifie donc aussi (et peut-être surtout) s’éloigner de manières d’habiter agencées autour du chacun chez soi. Si chaque foyer dispose de son logement propre, les espaces communs et les temps partagés en commun sont multipliés. Matériellement, l’immeuble Ékoumène dispose d’un atelier collectif, de buanderies communes où se partagent machines à laver et espaces de séchage, de grands paliers dont l’aménagement montre qu’ils sont investis et habités, un petit hall d’entrée avec un panneau d’affichage qui reçoit les cartes postales envoyées à l’ensemble des habitant·es, les affiches et flyers invitant à des rencontres, manifestations, spectacles que l’un·e d’entre nous souhaite publiciser, ou simplement l’annonce d’un apéro à tel étage, tel jour à telle heure. Ce hall accueille aussi souvent quelques cartons de vêtements, de chaussures, des cageots de fruits ou légumes donnés ou ramassés et accompagnés de l’écriteau « servez-vous ! », et en période estival un gros tube de crème solaire à disposition. La cour de l’immeuble et le local associatif Le Cinquième sont deux espaces où se croisent habitant·es et non-habitant·es.
Mais plus encore, c’est dans l’organisation, la gestion et finalement la vie quotidienne que se perçoit le mieux une tentative de sortie de l’idéologie propriétaire – et du quotidien qui va avec. Nous l’avons dit, l’immeuble est perçu et organisé comme une grande maison, et pour la faire vivre cela nécessite une réunion d’habitant·es tous les quinze jours, suivie d’un repas préparé par l’un des foyers ; les séances de jardinage, de nettoyage ou de rangement sont aussi l’occasion de moments collectifs. Ces temps de réunions, de repas, de chantiers collectifs, etc. ne sont pas obligatoires, aucune comptabilité des présent·es et absent·es n’est organisée – on y vient donc soit par plaisir, soit parce qu’on s’y sent quand-même obligé si l’on estime par exemple que l’on a été trop absent·e ces derniers temps.
Si la notion de communs appelle souvent, quand on parle d’habitat et dans les représentations habituelles, des images d’espaces physiques, il est nécessaire d’élargir la manière de regarder pour comprendre le travail des communs et les lignes qu’il fait bouger. Davantage que des lieux, les communs sont d’abord des occasions et des situations propices à leur émergence. Nous nous retrouvons ainsi très souvent à discuter de ce qui relève habituellement du domaine du privé, c’est-à-dire de ce qui ne se discute pasxiv. Et, pour commencer, nous discutons (à l’image de bien d’autres collectifs construisant des communs) de ce qui peut ou doit relever du domaine de ce qui se discute ou non, de la délimitation de ce qui peut se discuter collectivement. Pouvoir discuter de ce qui relève habituellement de la sphère privée et qui peut éventuellement glisser vers une dimension collective voire politique est un signe du travail des communs. Il peut s’agir de choses qui semblent anecdotiques comme les pratiques du jardinage (et donc la manière d’utiliser l’espace, de concevoir le rapport à son environnement, d’expérimenter des manières de faire), le partage ou la mutualisation des outils, etc., mais, de manière plus questionnante vis-à-vis de l’idéologie propriétaire, ces discussions peuvent concerner le partage des machines à laver ou des voitures – qui interroge notre lien entre la possession de choses à soi et notre propre existence subjective.
De manière moins matérielle mais paradoxalement plus profonde, les façons de consommer, le rapport à l’argent, l’éducation des enfants sont des choses qui sont de fait partagées : un enfant vient s’installer dans un appartement ou d’autres enfants regardent un film, mais finalement ses parents viennent le chercher parce qu’il en a déjà regardé un dans la journée, ou qu’il n’est pas autorisé à regarder ce type de film ; une soirée s’éternise, les enfants veulent veiller aussi, mais certains doivent aller se coucher alors que d’autres non… Sans que ce soit nécessairement discuté, tout cela en tout cas se partage. Chacun et chacune, enfant comme adulte, en tirera les conclusions qu’il ou elle veut, mais cela viendra questionner des pratiques qui habituellement restent dans l’univers du foyer. D’autres choses se discutent nécessairement, et notre conseillère à la banque s’étonne de notre connaissance précise des ressources de chaque membre du groupe, résultat de notre travail en commun depuis le lancement du projet et conséquences de nos statuts qui obligent à cette discussion sur les moyens financiers de chacun·e.
Tout cela se déroule aussi bien lors de réunions formelles que lors de rencontres dans la cour, les paliers où sont installés des tables et des fauteuils, les buanderies ou simplement lors de temps conviviaux chez les un·es et les autres. Cette manière d’habiter fabrique du politique, au sens d’une discussion entre égaux qui vise à changer délibérément le mondexv. La matrice centrale de l’ensemble du projet est l’institution et la mobilisation d’espaces communs, matériels et immatériels, supports d’une perméabilité, d’une porosité possible entre l’expérience habitante et le politique. Insistons sur le fait que le politique n’est pas pour nous une affaire de gestion des affaires courantes, mais bien la création de zones de turbulences qui provoquent de l’inédit et interpellent l’existant. Cela ne va pas sans heurts, sans incompréhensions, sans agacements, sans résistances. Si nous avons pu avancer, et continuons de le faire, sur des mécanismes de solidarité financière, le groupe a néanmoins (partiellement) buté sur la prise en compte des revenus autres que ceux générés par le travail dans la prise en compte des ressources des un·es et des autres, par exemple les héritages – sujet typique qui entremêle des dimensions personnelles, familiales, descend profondément dans l’inconscient de chacun·e, et interroge à la fois certaines modalités d’organisation de notre société et la naturalisation-invisibilisation de certaines inégalités sociales. Au moins ces sujets de débats permettent-ils de mettre au jour des thèmes bien peu abordés dans la société.
Les communs à contre-courant
Sortir ou tenter de sortir de ces cadres dominants et des évidences qu’ils dessinent demande de s’en extraire mentalement et pratiquement, cela exige une capacité collective à ne pas se laisser coloniser. Vouloir sortir de la logique de marché et de la spéculation immobilière (maximiser des gains individuels) suppose ainsi de trouver des failles dans des dispositifs législatifs et juridiques qui contraignent explicitement à la suivre (obligation de suivre le prix du marché pour les loyers ou la vente d’un bien immobilier par exemple). Pareillement, la logique bureaucratique s’impose avec force par une multitude de règlements qui, des conditions de contractation de prêts immobiliers aux conditions de fourniture d’énergie, en passant par la manière même d’encadrer la construction de logements, impose une logique individuelle et n’envisage que la propriété privée. C’est aussi du point de vue des représentations et des imaginaires qu’il faut lutter puisque lorsque nous constatons que les règlements sont moins contraignants que ce qu’on nous laissait accroire ou bien qu’ils peuvent être facilement détournés, c’est alors contre des préjugés tenaces et des routines conservatrices qu’il nous faut dépenser notre énergie – expliquer, argumenter, insister, se fâcher, rendre public, etc.
Les habitant·es d’Ékoumène, comme tout groupe qui déploie un travail des communs, se confrontent aux banques, aux professionnels de la production du logement, aux élu·es des collectivités locales qui se montrent peu disposé·es à sortir de la dichotomie dominante entre la propriété privée exclusive et la propriété étatique, aux administrations et à des règlements qui servent bien souvent de prétextes faciles et à toute épreuve pour ne rien changer. Dans ce panorama d’un conservatisme sans surprise, il faut pourtant ajouter la présence de celles et ceux qui plus d’une fois nous ont sauvé la mise, dans les administrations comme dans les entreprises, porté·es par l’enthousiasme et des convictions, la volonté de faire bouger des lignes ou l’intérêt pour un groupe de futur·es habitant·es considéré comme sympathique et déterminé, et qui nous ouvrirent des portes, nous signalèrent des failles, des contournements possibles, des allié·es à rencontrer… Comment expérimenter sans cette présence d’une résistance ordinaire ?
Il n’en demeure pas moins que le régime culturel de privatisation que nous connaissons fait sentir sa présence massive et contraire à l’idée des communs. Il faut rappeler que cette sensation pesante de vent contraire n’a rien d’étonnant : l’avènement de notre modernité coïncide précisément avec la destruction intentionnelle des communsxvi. Cette destruction fut nécessaire à l’avènement du monde capitaliste et son régime socio-économique de privatisation. L’histoire est connue, elle commence en Angleterre dès le XVIe siècle et se généralisera ensuite : les commons, ces terres que leurs propriétaires ne pouvaient assujettir complètement du fait d’un droit coutumier qui les contraignait à en partager l’usage, allaient être délibérément transformées et privatisées pour lancer sur les routes des paysans sans ressources, soudainement obligés de vendre leur force de travail, privés des communs qui permettaient aux familles paysannes de déployer leur économie (pâturage, collecte) et leurs relations socialesxvii. La colonisation menée par les puissances européennes sur l’ensemble de la planète à partir du XVIe siècle reproduit à grande échelle cette destruction des communs et cette privatisation du mondexviii.
Ce premier mouvement de privatisation de terres sur lesquelles, jusqu’alors, personne ne pouvait prétendre exercer un droit absolu est nommé enclosure. Il désigne ce processus d’appropriation qui commence en Angleterre et se traduit physiquement par la clôture des terresxix. Un deuxième puissant mouvement d’enclosure est à l’œuvre depuis une cinquantaine d’année et donne une idée de la puissance et de la profondeur de ce régime mondial de privatisation qui est le nôtre : brevetabilité du vivant, marchandisation de la connaissance, de la culture et même de l’environnement (permis de polluer)xx. Quand tout est à vendre, c’est que le régime de privatisation s’est répandu sur terre, sur mer et dans les airs et a colonisé tous les domaines du monde social ou presque.
Cette privatisation ne se limite pas au droit, à des règlements ou des actes notariés (ces cadres législatifs et juridiques rappellent que l’État y contribue de manière activexxi), elle prend corps également dans des manières de voir et de considérer l’environnement et le monde social. Il s’agit d’un véritable régime culturel qui ne se résume pas à la privatisation des moyens de production, à la mise en concurrence d’individus sur le marché économique, à la brevetabilité d’à peu près tout, ce régime se déploie dans des sphères qui auparavant n’y étaient pas soumises, le domaine des « services publics » en donnent un exemple, qui sont colonisés par des logiques concurrentielles et finalement des manières d’agir propres au marchéxxii. Cette logique de privatisation est portée par des représentations qui se déploient donc dans des secteurs dont on pourrait penser qu’ils sont éloignés des logiques économiques capitalistes (l’éducation, la santé, la culture, mais on pourrait, en nous décolonisant des évidences, rajouter l’alimentation, l’énergie, etc.). Le logement en est un exemple, il dessine des formes contemporaines de repli sur soi, de privatisation des espaces et des esprits : multiplication des claustras, délaissement affectif et matériel des parties communes, méfiance vis-à-vis de ses voisin·es ou difficultés à construire des cadres de discussions collectives, idéal visé d’un paradis privé où tous les services sont réunis dans l’univers domestique, rêve d’indépendance qui n’est pas loin d’un rêve de solitude (aire de jeux pour enfants et piscine privatives, home-cinéma, etc.)xxiii. Les résidences et quartiers privés sont un condensé de ces tendances.
Le travail des communs se construit dans ce contexte socio-historique, dans ces espaces sociaux dévastés par le régime culturel de privatisation : non seulement les normes de la propriété privée occupent tout le champ des pratiques et des idées, mais les points d’appui encore existants pour construire des communs sont rares. On peut trouver ce constat exagéré, et les contre-tendances ne manquent pas, mais il suffit d’assister à des réunions de copropriété ou de participer à des visites de quartier avec des élus municipaux pour constater la difficulté à ne pas considérer seulement son seul logement ou son seul trottoir, pour s’apercevoir de la difficulté à délibérerxxiv. Et si dans ce paysage social traversé par la culture de la propriété privé, les références à d’autres pratiques et imaginaires sont rares, cela ne signifie pas qu’elles ne soient pas utiles, au contraire. En témoignent, dans le domaine de l’habitat, la connaissance et le rappel qui est fait à des expériences passées des communs, qu’il s’agisse des tentatives de familistères, des solidarités construites dans le réseau des Castors après la seconde guerre mondiale ou des expériences d’habitat autogéré des années 1970 et 1980xxv, autant de points d’accroches pour penser autrement, pour s’inspirer, pour ne pas partir de rien.
Mais il n’empêche que dans ce premier quart de XXIe siècle, en France et ailleurs, partager une machine à laver n’a rien d’évident, comme le rappelle le dicton populaire selon lequel on lave son linge sale en famille. Rien d’évident non plus dans le fait de partager des voitures, signe privilégié de distinction et de réussite (individuelle et privée). C’est un travail de fond.
Les communs, pour quoi faire ?
Ce travail de fond n’est-il simplement qu’une nouvelle manière de se distinguer ? Quelque chose qui serait discursivement très différent, mais finalement pas très éloigné des pratiques dominantes de notre temps ? Pour répondre à ces questions, sans doute faut-il partir de quelques repères concrets issus de notre expérience vécue. Il faut ainsi rappeler ce que nous avons appris dans cette manière d’habiter, par exemple que pour vivre en commun, nous avons pris comme habitude de suspendre n’importe quelle proposition si un·e seul·e d’entre nous émet une réserve, un doute ou une réticence – de nouvelles discussions ultérieures en feront naître une nouvelle qui satisfera chacun·e. Il faut aussi rappeler ce que nous avons consolidé, par exemple une capacité d’écoute et de délibération, une manière d’apprendre à différer les décisions pour que chacun·e prenne le temps de mûrir les arguments des un·es et des autres. Aujourd’hui certaines de nos pratiques des communs sont profondément incorporées : cette manière de se réunir, de délibérer qui dessine une subjectivation collective et dont témoigne l’organisation des enfants de l’immeuble, qui ont leur propres espaces de réunion et de délibération où se recherchent des compromis qui satisfassent chacun·e (choix d’une activité, d’un film, de la manière d’organiser une fête, un spectacle, etc.).
Mais chez eux aussi, les communs peuvent questionner et agacer : pourquoi partager avec les voisin·es la nouvelle voiture récemment acquise par les parents ? Pourquoi raccourcir le mur qui sépare la rue du local associatif pour le rendre plus ouvert et plus accessible alors la cour nous semblait réservée ? Ces remarques semblent signifier : ne peut-on pas jouir de ces biens propres de manière privée ? Mais dans cette tension qui vient rappeler qu’il y a bien un extérieur à Ékoumène, adultes et enfants viennent dire et redire au-delà de quelques frustrations et agacements que ce mode de vie en commun offre de multiples avantages.
Lesquels ? Les espaces de délibération sont des espaces pour grandir en se nourrissant des réflexions et des expériences des autres, et les espaces d’action collective permettent d’apprendre et d’expérimenter. Les connaissances qui y sont acquises seront remobilisées ailleurs et irrigueront d’autres espaces – logique politique de la pratique de communs. Ces compétences acquises et renforcées d’organisation, de comptabilité, de recherche d’informations et de personnes ressources, de bricolage, de jardinage, de contribution à des projets et actions ambitieuses et menées sur des temps longs… tout cela se diffuse dans nos engagements en dehors d’Ékoumène. Ce que nous ne pensions pas être en capacité de réaliser avant, nous le réinvestissons pourtant aujourd’hui ailleurs. C’est que le travail des communs renforce, y compris au plus profond des subjectivités individuelles. Ce qui étonne les visiteurs de passage fait pourtant partie de notre quotidien le plus banal, en premier lieu la facilité d’échange, la manière de poser collectivement des sujets de discussion pour l’action. Ce travail des communs dessine une espèce d’anti-propriété (centrage sur soi et ses biens propres) et d’anti-copropriété (valorisation de ce qui est privé, délaissement de ce qui n’est pas privé, souvent faible capacité à s’écouter, à prendre en compte l’avis des autres). Cela ne signifie pas que nous soyons obnubilé·es par l’idéologie propriétaire et que nous devions sans cesse nous y comparer, au contraire, c’est parce que nous sommes sortis de ses cadres obligés (nous ne disons pas définitivement et encore moins complètement) que nous n’y pensons plus guère. Ce sont les regards extérieurs qui nous font percevoir nos avancées, et celles-ci dessinent une forme d’autonomie de pensée et d’action.
La capacité à faire naître des espace de discussion où l’on écoute et où l’on sait être écouté – jamais garantie à 100% mais pourtant très fortement ancrée – est alors un mécanisme qui permet d’agir de manière ambitieuse et de sortir des sentiers battus. Ainsi, l’ambition de sortir de la propriété individuelle prend la forme, à Ékoumène, du renoncement à transmettre un bien à ses héritier.es, de la construction des solidarités financières qui permettent de sortir l’argent d’une connotation intime dont s’est emparée la psychanalyse dès ses débuts ! Cela n’a rien de simple, mais c’est là le travail des communs !
Construire des communs, c’est pratiquer une forme d’autogestion, d’autogouvernement. À Ékoumène cette dimension est bien modeste (une vingtaine d’habitant·es) mais elle vient dire un refus de l’expertise, autre combat à mener au jour le jour. Lors d’une réunion avec une collectivité locale, quand un cadre nous dit : « Nous vous soutiendrons si vous êtes accompagnés par des professionnels de ce type de projet », nous opposons une fin de non-recevoir : c’est une dimension qui n’est pas négociable ! Car refuser l’expertise, qui construit des hiérarchies et des spécialités qui excluent, est ce qui permet de conserver la main sur la manière de construire notre projet, de privilégier concrètement l’horizontalité des relations, de renforcer notre autonomie (dans les choix de vie, dans la manière de s’organiser collectivement). Cette recherche d’autonomie, contre l’hétéronomie proposée par le cadre dominantxxvi, signe une dimension incontestable des communs, celle qui consiste à ne pas se laisser déposséder, celle qui consiste au contraire à se réapproprier et les choses et les manières de fairexxvii. Le travail des communs, dans cet ordre d’idée, est aussi un pari de l’égalité.
Mais ce pari-là n’est jamais gagné facilement, car si à l’intérieur des expériences des communs s’expérimentent des relations placées sous le signe de l’égalité (à Ékoumène : « un·e associé·e, une voix », responsabilités tournantes et obligatoires, animation tournante des réunions d’habitant·es par le foyer qui accueille, etc.), vis-à-vis de l’extérieur la montée en compétence, le gain en assurance individuelle et collective pose nécessairement une question épineuse : les communs relèvent-ils d’une pratique qui s’adresse à des privilégié·es qui possèdent déjà un capital culturel, social, organisationnel et technique ? Et qui, par les pratiques des communs, les renforce, et par-là même, renforcent encore des inégalités vis-à-vis de celles et ceux qui n’en bénéficient pas ? Les communs, ne seraient-ils pas finalement un privilège de plus pour les privilégié·es du pouvoir d’agir ? Et dans ces conditions, non pas une réelle alternative à la dislocation sociale mais un élément de son renforcement ?
La question mérite d’être posée puisqu’y répondre par l’affirmative en limite leur portée et leur diffusion, et elle vient interroger des manières de concevoir le changement social dans des sociétés extrêmement stratifiées, et elle vient également interroger les dimensions de la vie sociale qui sont choisies pour créer des communs. L’habitat (habitat participatif, éco-hameaux), les modes de consommation (Amap, groupements d’achats, magasins coopératifs), les pratiques culturelles (friches urbaines, tiers lieux) ou numériques (ressources coopératives, logiciels libres) sont des espaces privilégiés d’expérimentation des communs dans les pays occidentaux, et il est difficile d’ignorer que ces espaces sont aussi ceux investis par des catégories de population qui ne sont pas les plus mal dotées en termes de capitaux de toute sortes (éducatifs, financiers, de réseau, etc.)xxviii. Les communs ne sont pourtant par nécessairement une pratique de classe sociale privilégiée, au contraire ils sont d’abord dans les sociétés paysannes un moyen de survie permettant de résister à l’accaparement des terres par des propriétaires terriens. Les luttes de grande ampleur menées en Bolivie au début des années 2000 par les populations autochtones contre la privatisation de l’eau, luttes qui sont considérées comme les premiers retours des communs à l’ère du néolibéralisme, témoignent d’un ancrage populairexxix. Toujours en Bolivie, la seconde ville du pays, El Alto, connaît un processus impressionnant de travail des communs par plus de 700 assemblées de voisin·es qui sont amenées à construire et gérer une grande partie des infrastructures et services (construction d’écoles, de places publiques, de réseaux d’assainissement, contrôle de magasins de première nécessité, etc.) dans une contexte de grande pauvretéxxx. Le travail des communs ne s’adresse pas nécessairement aux mieux dotés.
Cela n’empêche pas d’admettre qu’il peut prendre une autre voie, et le risque alors est grand de transformer le travail des communs en construction d’oasis agréables et relativement protégées des vicissitudes du monde. Ékoumène n’échappe pas à ce risque, quelques évènements en témoignent, qu’il s’agisse de remarques venues de personnes ayant participé à des rencontres à Ékoumène et tiquant sur le fait que ce projet semble construit par des gens à qui tout réussit, ou qu’il s’agisse de la tension qui naît chez les habitant·es entre une déclaration de principe sur l’ouverture et l’accueil de l’altérité sous toutes ses formes et la confrontation réelle à cette altérité qui surprend, agace et dérange nos habitudes, nos manières de faire et nos manières d’être.
Semer le trouble (au risque sinon de s’enfermer)
Est-il possible, dans notre société cloisonnée, que ce travail des communs ne soit pas l’apanage des privilégié·es du pouvoir d’agir, au risque sinon de transformer les communs en paradis privés réservés à quelques-un·es, renouant ainsi, malgré le long détour, avec le régime culturel de la privatisation ?
Si le politique est une manière d’agir qui vient interroger nos usages du monde et bouleverser des manières de faire et de penser, le travail des communs doit alors sans doute éviter l’ornière de l’étiquetage facile qui permet à chacun·e de venir se ranger dans la bonne file – cloisonnement bien incapable de produire les remous nécessaires à produire du neuf. Étiqueter c’est par exemple ranger les communs dans la case des pratiques sociales consensuelles du bien vivre (sorte de solution sans remous dont s’empare les collectivités locales par exemple) ; étiqueter c’est inversement, et pour résister à cette aseptisation politique, placer les communs sous l’étendard de slogans (autogestion, écologie, coopération, etc.). Dans les deux cas c’est s’adresser, comme les communicants, à des publics-cibles dont on sait à l’avance que ce discours leur conviendra. Le risque est alors de créer un horizon politique et pratique surdéterminé où chacun·e connaît sa place à l’avance, où les espaces réclament une certaine manière de parler, de penser, de se comporter xxxi. N’est-il pas possible au contraire de faire en sorte que les communs s’adressent à celles et ceux qui n’y avaient pas pensé et à qui on ne pensait pas ?
Il semble en effet que les expériences des communs aient à leur disposition une autre manière de fonctionner, qui s’arrime nécessairement à un horizon politique mais qui conserve néanmoins des pratiques qui soient suffisamment indéterminées pour pouvoir semer le trouble dans les catégories habituellesxxxii. Qu’est-ce que cela signifie ? Que le travail des communs, dans un contexte d’ultra-privatisation (matérielle et symbolique) et de bureaucratisation, ouvre sur des pratiques qui ne sont pas saturées de certitudes (offrir l’alternative clef en main) et qui permettent ainsi de s’interroger et de semer le trouble dans les catégories d’évidence. Les communs, par exemple, permettent de reconsidérer l’opposition binaire public (État) / privé (le reste) autour de laquelle s’articulent des positions politiques bien définies, chacune occupant depuis des décennies des terrains bien définis.
À un niveau bien modeste mais néanmoins significatif du travail des communs, la cour à Ékoumène et les paliers aménagés de l’immeuble peuvent donner un aperçu d’espaces pas tout à fait définis : ils ne sont ni véritablement privés ni véritablement publics, les visiteurs en franchissent le seuil en s’interrogeant sur leur statut. Ces espaces sont indéterminés dans le sens où leur fonction et leur fonctionnement ne se laissent pas comprendre d’emblée : on ne sait pas trop où on est, on ne sait pas trop qui sont les gens qui sont là, on perd quelques repères. Le groupe d’habitant·es lui-même jouit encore, après 5 ans, de ce statut indéterminé : communauté ? grande famille ? rassemblement d’ami·es ? autre chose pour laquelle on pourrait trouver un autre nom ?
Cette indétermination laisse ouvert un espace possible de rencontres et surtout des places qui ne sont pas attribuées d’avance à celles et ceux qui nous rejoignent. Les acteurs et actrices des réseaux de l’habitat participatif présentent souvent cette manière d’habiter comme une troisième case entre la propriété privée et la communauté, fermant la porte à cette indétermination qui laisse les possibles ouverts. Un projet qui n’est pas surdéterminé permet en effet aux personnes qui le vivent d’expérimenter, de se découvrir, certain·es diront qu’ils ou elles ont besoin de davantage d’intimité, d’espace préservé quand d’autres au contraire se découvriront un goût pour davantage de collectif. Mais l’espace n’a pas été saturé à l’avance, les pratiques peuvent bouger, se recomposer, etc. C’est dans ce jeu, dans ce mécanisme un peu bancal, pas tout à fait réglé, qu’autre chose, qui n’existe pas encore, peut s’expérimenter.
Semer le trouble participe à la diffusion des pratiques des communs, en ne remplissant pas à l’avance tous les espaces, en laissant du vide où puissent s’insérer des personnes, des expériences, des récits, des projets, des idées, des désirs. Après trois ans de fonctionnement, Le Cinquième n’est toujours pas surchargé d’affiches, de tracts, d’éléments qui viendraient dire d’office où l’on se trouve précisément – ce qui laisse de la place pour que d’autres puisse l’occuper aussi. Éteindre ces formes d’indétermination revient à étouffer les milieux dans lesquels les communs prennent forme, se réalisent et se diffusent, ou revient à privatiser ces espaces qui ne s’adressent alors qu’à des catégories déterminées. La force des communs n’est-elle pas de pouvoir rassembler autour de thèmes, de questions, de revendications qui rassemblent plutôt qu’un moyen de se retrouver confortablement entre pairsxxxiii ? L’enjeu est de taille, puisqu’il joue avec des manières d’être profondément ancrées en chacun·e et qui servent de marqueurs (classe sociale, genre, origine culturelle, niveau d’études, etc.), et si ceux-ci sont par trop évidents ils agiront nécessairement comme une puissante source d’exclusion pour celles et ceux qui ne les partagent pas. Et il ne suffira pas de crier sur tous les toits que notre espace est ouvert à qui veut bien pousser la porte pour que cette réalité change. Une forme de variété dans la composition d’un groupe ou son renouvellement régulier peut aider à ne pas figer son identité et contribuer à y faciliter l’entrée. Mais cette variété n’est pas la caractéristique des habitant·es d’Ékoumène (l’âge, un parcours associatif commun, un niveau d’étude proche, des revenus assez similaires, etc. en font un groupe homogène), c’est donc par le biais de l’association que va pouvoir s’expérimenter une forme d’ouverture, de contagion des communs. La forme associative (ni tout à fait privée, ni tout à fait publique), Le Cinquième (local associatif dont l’aménagement ne fait penser ni à un lieu tout à fait public ni à un espace privé), les actions qui y sont menées (les soupes gratuites mensuelles qui ne sont ni un repas entre ami·es, ni un repas de famille, où de nouvelles têtes apparaissent chaque mois mais où tout le monde est vite appelé par son prénom…) sont alors autant d’éléments qui peuvent semer le trouble, c’est-à-dire qui peuvent ouvrir un espace suffisamment indéterminé où l’on peut prendre sa place autour de moments collectifs ou de projets qui seront décidés en commun sans trop devoir se poser la question : « Suis-je bien à ma place ? »
La seconde partie de notre discussion (à paraître dans le numéro suivant) s’attache à l’expérience de l’association Ékoumène comme espace intermédiaire entre la vie en commun déployée dans l’immeuble et le dehors, c’est-à-dire comme lieu du travail politique des communs, un milieu où s’expérimente la diffusion des communs. Cette tension entre un dedans et un dehors est-elle suffisante pour préserver le travail des communs d’un glissement toujours possible vers de nouveaux paradis privés où chacun·e s’assoupit dans un espace confortable et protégé ? Car selon nous, dans ce travail des communs il y a une puissante dimension existentielle, bien trop peu prise en considération quand il s’agit de le décrire ou de l’analyser. Penser la diffusion des communs suppose de ne pas l’ignorer, et de garder en tête le contexte d’ultra-privatisation qui nous entoure et nous traverse, qui agit et fait agir. Depuis ce point de vue terre à terre, comment essayons-nous de diffuser les communs ? Faut-il alors privilégier une diffusion qui se déploie « non plus en termes de conscience mais de contagion », c’est-à-dire insistant sur des pratiques quotidiennes et sur la manière dont elles résonnent avec d’autresxxxiv ? Ou bien, pour dépasser le microcosme de cet archipel des communs qui donne l’impression de construire de petits mondes hermétiques, faut-il se rapprocher de celles et ceux qui affirment que l’expansion des communs doit dépasser cette diffusion par le bas afin de gagner en force et ne pas disparaître dans un océan libéralxxxv ?
1 Cet article est composé de deux parties, la seconde paraîtra dans le prochain numéro d’Agencements : « Une manière de diffuser les communs : l’expérience d’Ékoumène [Réflexions sur la diffusion des communs / 2] ».
L’article comporte un appareil théorique important réuni en notes de fin, celles-ci peuvent être lues comme un texte à part, et l’article lui-même est écrit sans qu’il soit nécessaire de se référer systématiquement à ces notes.
i Pierre Dardot et Christian Laval, Commun, Essai sur la révolution au XXIe siècle, La Découverte, Paris, 2014. L’ouvrage cherche à faire de la pratique instituante du commun le point d’appui de ce qui est présenté comme « la » révolution du 21ème siècle, déjà commencée : « Terme central de l’alternative au néolibéralisme, le ‘‘commun’’ est devenu le principe effectif des combats et des mouvements qui, depuis deux décennies, ont résisté à la dynamique du capital et ont donné lieu à des formes d’action et de discours originales. Loin d’être une pure invention conceptuelle, il est la formule des mouvements et des courants de pensée qui entendent s’opposer à la tendance majeure de notre époque : l’extension de l’appropriation privée à toutes les sphères de la société, de la culture et du vivant » (p. 16). Le commun est ainsi considéré comme une pratique servant à dé-privatiser et à re-politiser, « tout véritable commun politique doit son existence à une activité soutenue et continue de mise en commun » (p. 236).
ii David Bollier, La Renaissance des communs. Pour une société de coopération et de partage, Éditions Charles Léopold Mayer, Paris, 2014. L’auteur présente le mouvement des communs comme une force tranquille dont l’attraction est tellement évidente qu’elle avance sans réelle résistance : « Comme nous le verrons dans les pages qui suivent, le paradigme des communs recèle un potentiel inestimable pour réinventer des États en panne et réformer des marchés prédateurs. » (p. 16) ; « C’est précisément ce que s’emploie à faire aujourd’hui un puissant mouvement des communs tout autour de la planète. Celui-ci invente de nouveaux modèles de production, des formes plus ouvertes et responsables de gouvernance, des cultures et des technologies innovantes, des modes de vie sains et attractifs. C’est une révolution tranquille – autoorganisée, diverse et citoyenne. […] Il semble destiné à une expansion continue, parce que les diverses tribus transnationales de commoneurs parviennent de mieux en mieux à se trouver et à coordonner leurs efforts et leurs réflexions pour faire cause commune contre les dysfonctionnements toujours plus manifestes de l’État/marché et contre sa paranoïa antidémocratique »(p. 17).
iii Hannah Arendt, La Crise de la culture, Gallimard, Folio essais, Paris [1954-1968] 1972, p. 215.
iv Jacques Rancière, Aux bords du politique, Gallimard, Folio Essai, Paris, 1998 : « La démocratie n’est ni l’autorégulation consensuelle des passions plurielles de la multitude des individus ni le règne de la collectivité unifiée par la loi à l’ombre des déclarations des Droits. Il y a démocratie dans une société autant que le démos [le pouvoir du peuple] y existe comme pouvoir de division de l’okhlos [la passion de l’Un qui exclut, le rassemblement effrayant des hommes effrayés] » (p. 66) ; la démocratie est une communauté polémique (p. 92) et l’essence de la politique est le dissensus (p. 244).
vNotre réflexion se déploie sur 2 articles, la question de la diffusion est particulièrement traitée dans le second : Une manière de diffuser les communs : l’expérience d’Ékoumène [Réflexions sur la diffusion des communs / 2]. Cette première partie aborde les manières dont s’invente et se déploie la pratique des communs, dans quelles conditions et pour quels résultats.
vi Au départ de notre réflexion nous avions décidé de mobiliser d’autres expériences des communs, auxquelles nous avions participé ou que nous avions fréquentées. Il nous a finalement semblé plus pertinent de ne parler que d’Ékoumène pour partir de nos pratiques quotidiennes et incarner au mieux notre manière de voir. Pour autant, si cet article ne relate qu’une seule expérience, notre réflexion se nourrit d’autres situations connues de première main et dont nous avons déjà rendu compte par écrit : Pierre Servain, Faire de l’habitat un espace commun. Le travail d’appropriation habitante dans les habitats participatifs, thèse de doctorat, Université de Bretagne Occidentale, Brest, 2020 ; Guillaume Sabin, L’Archipel des Égaux, luttes en terre argentine, PUR, Rennes, 2014 ; Collectif Caracolès, Petite contribution pour semer des mauvaises graines (alternatives rurales en Bretagne), 2011 ; Collectif Caracolès, Le Collectif enragé (expérience d’éducation populaire en milieu urbain), Brest, 2006.
vii Partir du terre-à-terre, du prosaïque, de la vie quotidienne, de nos engagements pratiques permet de ne pas se laisser contaminer par une caractéristique de notre temps, à savoir produire en masse une pensée désincarnée. Selon celle-ci tout pourrait être pensé, dit, écrit, sans que cela impacte l’existence de l’auteur ou de l’émetteur, sans que cela soit relié à une trajectoire personnelle, à une manière d’agir ou de vivre. Au risque de paraître moral ou intrusif, nous voulons signifier le caractère insidieux de cette forme de désincarnation de la pensée qui sous-entend que penser ou dire ceci ou cela est de toute façon sans conséquence pratique, éthique ou existentielle. Pour une critique des conséquences de cette pensée désincarnée, nous renvoyons à l’ouvrage du Collectif de onze femmes de l’association La Grenaille, Éducation populaire et féminisme. Récits d’un combat (trop) ordinaire. Analyses et stratégies pour l’égalité,2016.
viii Sur cette définition des communs comme activité sans cesse « au travail » nous renvoyons au chapitre 1 du livre de Pierre Dardot et Christian Laval, Commun, essai sur la révolution au XXIe siècle, La Découverte, Paris, 2014 et à l’introduction de Pascal Nicolas-Le Strat de son ouvrage Le travail du commun, Éditions du Commun, Saint-Germain-sur-Ille, 2016. Le fait de considérer les communs comme une activité permet de sortir de l’idée répandue selon laquelle il y aurait certains biens prédisposés à être des communs (les rives et rivages, les pâturages en zones de montagne, les canaux d’irrigation en zones agricoles, etc.). En effet, la pratique des communs peut concerner tout type de biens et d’activités humaines, y compris ceux qui en semblent les plus éloignés (l’habitat et la voiture pour n’en rester qu’à des exemples qui nous concernent ici). En cela il y a symétrie avec les pratiques de privatisation qui elles aussi peuvent coloniser absolument tous les espaces sociaux (culture, éducation, santé…) y compris les aménités et ressources naturelles telles que l’eau, l’air, etc. Dans un régime culturel de privatisation rien ne peut être soustrait a priori à cette possibilité d’être doté d’un propriétaire. Dans ce contexte, le travail des communs est bien une pratique qui vient s’opposer ou contrebalancer la logique de privatisation.
ix En droit français, la dimension exclusive de la propriété se décline en particulier dans l’article 544 du Code civil : « La propriété est les droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. » Le montage juridique du projet Ékoumène s’extraie de cette idéologie propriétaire : aucun·e habitant·e n’est pleinement propriétaire de son logement, ce qui vient rompre avec le plus absolu des droits sur les choses (plena in re potesta) qui est celui de la propriété privée telle que nous la connaissons aujourd’hui et qui adjoint le droit d’usage (usus), le droit sur les fruits (fructus) et le droit d’abuser (abusus, c’est-à-dire le droit de disposer entièrement d’un bien, en pouvant le vendre, l’altérer voire le détruire) (Dardot & Laval, Commun, Essai sur la révolution au XXIe siècle, op. cit., p. 248-249).
x Sarah Vanuxem dans son livre La propriété de la terre, Wildproject, Marseille, 2018, relativise le commentaire qui est fait habituellement et de longue date sur le caractère « absolu » de la propriété, entériné par cet article 544 du Code civil. Pour elle, le qualificatif « absolu » ne signifie pas ici le droit de faire n’importe quoi du bien possédé : il faut lire le terme comme une manière de conforter la propriété en tant que droit opposable à tout tiers d’en disposer (en respectant les règlements qui peuvent en limiter l’usage, l’exploitation, la modification, etc.) (p. 65-76). Que l’on retienne l’une ou l’autre des lectures de l’article 544, le montage juridique qui préside à la création d’Ékoumène vient en limiter le caractère d’absoluité : aucun·e des habitant·es, y compris l’association Ékoumène comme associée personne morale et occupant à titre gratuit le local Le Cinquième, ne jouit de la faculté de modifier substantiellement le logement qu’il ou elle occupe, non plus qu’il ou elle n’a un droit individuel sur celui-ci.
xi Elinor Ostrom dans son ouvrage, devenu un classique des questions sur les communs, Gouvernance des biens communs. Pour une nouvelle approche des ressources naturelles, Deboeck Supérieur, Bruxelles, 2010 (initialement paru aux États-Unis en 1990), décrit des systèmes de communs dont les règlements permettant une autogestion des ressources remontent à plusieurs siècles, aussi bien en Europe (p. 82) qu’en Asie (p. 105). Guillaume Sabin a montré comment, le long de la Cordillère des Andes, les systèmes de communs bien antérieurs à la colonisation espagnole étaient aujourd’hui actualisés et objets de lutte face au régime de privatisation que l’on connaît sur toute la planète (L’Archipel des Égaux, luttes en terre argentine, Pur, Rennes, 2014, p. 63-79).
xii L’invention de ces statuts (couplage Sci-association avec 99% des parts sociales détenues par l’association ; apports financiers principaux des associé·es passant par les comptes-courants d’associé·es ; assemblée des associé·es souveraine et cogérance réduite à l’exécution des décisions prises collectivement ; co-gérance tournante et obligatoire ; principe du « un·e associé·e, une voix », etc.) ne signifie pas qu’ils naissent de rien. Le groupe qui compose la commission Statuts d’Ékoumène s’est grandement inspiré d’autres expériences des communs, notamment en milieu rural, qui elles-mêmes utilisaient ce type de couplage et réfléchissaient à la possibilité de se mettre à l’abri de la spéculation foncière et immobilière et du marché de l’immobilier. Des projets collectifs de rénovation qui partaient parfois de bâtiments en ruine voyaient leur prix exploser une fois la rénovation menée à termes, et un·e associé·e qui souhaitait faire réévaluer ses parts sociales pour faire une plus-value au moment de son départ pouvait mettre en péril l’existence même du projet collectif. Ces expériences en milieu rural mutualisent leurs compétences dans de multiples réseaux, notre porte d’entrée fut celle des réseau Relier et Terre de liens, et le guide juridique qu’ils éditèrent conjointement nous fut d’une aide précieuse : Guide méthodologique, juridique et financier. L’accès collectif et solidaire au foncier et au bâti (Relier et Terre de liens, 2006).
xiii Le terme « autopromotion » désigne le fait qu’un collectif de futur·es habitant·es ne passe pas par un promoteur immobilier ou un aménageur et prenne en main des tâches qui sont dévolues d’habitude à des professionnels du bâtiment et de l’immobilier. Les communs, selon nous, sont une pratique d’anti-expertise qui permet de se ressaisir de domaines laissés à des spécialistes – logique qui dépolitise le monde social en transformant des sujets de société propres à être discutés et à soulever du dissensus (urbanisme, énergie, habitat…) en spécialités technocratiques se limitant à une approche technique et gestionnaire qui se satisfait du monde tel qu’il est et le renforce.
xiv Sur cette manière de discuter collectivement de ce qui est habituellement conservé et conversé dans le domaine strictement privé du foyer ou du couple, nous renvoyons au passage de la thèse de doctorat de Pierre Servain Faire de l’habitat un espace commun. Le travail d’appropriation habitante dans les habitats participatifs, Université de Bretagne occidentale, 2020, p. 159-165. Jacques Rancière rappelle l’idéal du tyran athénien Pisistrate : que les pauvres s’occupent de leurs affaires privées, afin qu’« ils n’aient ni le désir, ni le loisir de s’occuper des choses communes », ce travail de dépolitisation reposant sur la privatisation de la vie sociale n’a donc rien de neuf (Aux bords du politique, Gallimard, Folio Essai, Paris, 1998, p. 46).
xv Hannah Arendt développe cette définition du politique dans Qu’est-ce que la politique ?, Seuil, collection Points Essais, Paris, 1995.
xvi Les communs, dans le monde européen pré-capitaliste, se déploient concrètement et principalement dans les terres et pâturages communaux. Cf. Nadine Vivie, « Communaux (approche historique) », dans Marie Cornu, Fabienne Orsi, Judith Rochefeld (dir.), Dictionnaire des biens communs, Puf, « Quadrige », Paris, p. 254-257. Ils prennent sur le reste de la planète et avant la colonisation européenne, des formes multiples mais qui organisent souvent l’ensemble de la vie sociale, c’est par exemple le cas des territoires de l’Empire Inca fonctionnant sous le régime de l’ayllu, organisation communautaire reposant sur l’indivision des terres communautaires, l’usufruit de parcelles familiales et les travaux collectifs par rotation, système qui régit encore des régions entières de Bolivie (Guillaume Sabin, L’Archipel des égaux…, op. cit, p. 143 et 385).
xvii Dès le XVIe siècle, l’Angleterre connaît un processus violent de spoliation des terres communales utilisées par les paysans. L’usurpation commencée par les seigneurs va se poursuivre et se généraliser sous le régime parlementaire : en Angleterre, en Écosse, en Irlande on expulse les paysans, on détruit leur maison, on les chasse sur les routes pour les remplacer par des moutons dont l’industrie textile naissante a besoin. Karl Marx est le premier à souligner le lien entre la destruction des commons et la naissance d’un nouveau régime économique (le capitalisme). Marx résume ce procédé qui dura jusqu’à la moitié du XIXe siècle de la façon suivante : « L’aliénation frauduleuse des domaines de l’État, le pillage des terrains communaux, la transformation usurpatrice et terroriste de la propriété féodale ou patriarcale en propriété moderne privée » allait livrer « à l’industrie des villes les bras dociles d’un prolétariat sans feu ni lieu » (Le Capital, Livre I, sections VII à VIII, Éditions sociales, Paris, [1867] 1973, p. 174).
xviii Karl Polanyi a consacré son ouvrage, La Grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps, Nrf Gallimard, Paris [1944] 1972, à décrire et analyser la destruction programmée de toutes formes d’organisation sociale reposant sur la logique des communs pour faire advenir ce nouveau régime économique et social qu’est le capitalisme. Dans les Amériques, en Afrique, en Asie on assiste, via la privatisation des terres, l’obligation de payer un loyer et le recours à l’impôt pour obliger les populations autochtones à recourir au travail salarié, à la globalisation de ce nouveau régime individuel de propriété. L’État (colonial) joue un rôle majeur pour que perdure ensuite ce modèle socio-économique imposé par la force : « Le laissez-faire n’avait rien de naturel ; les marchés libres n’auraient jamais pu voir le jour si on avait laissé les choses à elles-mêmes. […] Entre 1830 et 1850, on ne voit pas seulement une explosion de lois abrogeant des règlements restrictifs, mais aussi un énorme accroissement des fonctions administratives de l’État, qui est maintenant doté d’une bureaucratie centrale capable de remplir les tâches fixées par les tenants du libéralisme » (p. 189).
xix Karl Marx a consacré le chapitre XXVII du Capital à la description du processus d’expropriation des terres communales (Le Capital, op. cit., p. 157-174). Le terme enclosure désigne cette « usurpation des biens communaux et de tenures individuelles par l’effet de la puissance seigneuriale », biens qui « furent ensuite expropriés et clôturés dans le but précis de les soustraire au régime précédent des droits d’usage » (Florence Gauthier, article « Enclosure », Dictionnaire des biens communs, op. cit.).
xx C’est le juriste James Boyle qui introduit l’idée de second mouvement des enclosures en filant la métaphore des enclosures pour désigner la privatisation, au moyen de la propriété intellectuelle, d’autres domaines relevant jusqu’alors de ce qui étaient non-appropriable par une personnes physique ou morale (« The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain », Law and Contemporary Problems, vol. 66, 2003, p. 33-74). Geneviève Azam illustre cette nouvelle rupture par la décision, en 1980, de la Cour suprême des États-Unis d’accorder une demande de brevet sur une bactérie pour le compte de la société General Electric. Cet épisode ouvre la voie à la brevetabilité du vivant mais aussi, indirectement, à la transformation de la connaissance en marchandise (« La connaissance, une marchandise fictive », dans la Revue du MAUSS semestrielle, 2007, La Découverte-MAUSS, n°29, Paris, p. 110-126).
xxi L’État contribue en effet fortement à l’idéologie propriétaire. Ainsi, l’appareil législatif et juridique français est tout sauf favorable à la sortie d’une propriété privée exclusive. Citons en particulier, dans le domaine de la gestion des biens immobiliers, la loi Chalendon de 1971. Celle-ci rend quasiment impossible la constitution de coopératives d’habitat, au profit des statuts de propriété et de copropriété privées et de la professionnalisation de la promotion immobilière (Chantal Dauchez, « Les coopératives de logement. Approche historique », dans Lerousseau (dir), L’habitat coopératif, Michel Houdiard Éditeur, Paris, 2014, p. 39-54). Depuis lors, les réseaux regroupés autour du Mouvement pour un Habitat Groupé Autogéré des années 1970 et 1980 puis ceux du Mouvement de l’Habitat Participatif à partir du milieu des années 2000, visent précisément à promouvoir des statuts juridiques alternatifs à la propriété privée pour habiter autrement. En plus d’être très généralement présenté comme l’unique option envisageable de la part des notaires et des banquiers, le statut de la propriété ou de la copropriété privée se montre très souvent le seul permettant de prétendre à des aides publiques ou simplement à un cadre fiscal favorable (prêts à taux zéro, aides fiscales à la construction ou la rénovation…). Les militant·es du Mouvement pour l’Habitat Participatif parviennent à provoquer l’insertion, dans la loi Alur de 2014, d’un chapitre permettant de constituer des sociétés d’habitat alternatives à la propriété privée classique, exclusive et absolue. Mais, de l’aveu même de leurs principaux promoteurs, leurs effets se montrent finalement décevants au-delà de leur dimension symbolique et médiatique : non seulement les décrets d’applications n’ont jamais été publiés, et quand bien même ils le seraient, force est de constater que ces nouveaux statuts ne représentent pas des avancées très significatives par rapport aux sociétés civiles coopératives de construction (Sccc) et sociétés civiles immobilières d’attribution (Scia) déjà existantes : tout comme elles, elles sont destinées à devenir des copropriétés une fois les logements construits. Le climat juridique semble même s’être détérioré à propos de ces statuts pourtant assez inoffensifs pour le cadre dominant, à en juger par le redressement fiscal, en 2020, d’une Scia qui aboutit à l’obligation des sociétaires de payer la Tva sur les appels de fonds liés à l’achat du terrain, faisant craindre que ce jugement serve de précédent et condamne de fait tout montage juridique similaire. Ces quelques faits appuient le propos d’Elinor Ostrom, pourtant peu encline à des formes d’analyses politiques radicales, montrant comment l’État, y compris lorsqu’il incite à la création de communs, les étouffe finalement (Gouvernance des biens communs…, op. cit., p. 176, 212-215).
xxii Le régime privatif du marché n’est pas qu’une simple réalité périphérique, il est une idéologie et une pratique qui colonise tous les espaces, matériels et idéels. Ce régime s’est appuyé sur l’État qui est devenu son allier incontournable, par les règlements qui contraignent à suivre cette logique de privatisation (K. Polanyi, La Grande transformation, op. cit.). La consolidation de cette machine administrative produit ainsi de nouvelles normes et de nouvelles hiérarchies (Michael Hardt et Antonio Negri, 2000, Empire, 10-18, Paris, 2000), y compris dans des secteurs qui semblaient être protégés de ce régime de privatisation. Le milieu de la recherche publique est symptomatique de ces transformations : la concurrence (entre entités et entre individus) qui passe par le financement par projet, par l’organisation d’une compétitivité, par des bourses, poste, chaire dites d’excellence impose une logique individuelle. C’est un terreau idéal pour individualiser et n’être bientôt plus capable de penser en termes de coopération, et encore moins de travail des communs. « Là où le marché ne peut être défini en termes de transactions économiques, où la définition de l’ ‘‘offre’’ et de la ‘‘demande’’ est quelque peu fictive, le mode d’évaluation devra faire exister cette fiction. Il devra mettre les ‘‘évalués’’ en compétition les uns avec les autres de manière telle que ce qui compte pour eux, et qui donne sens à leur activité, se trouve redéfini comme ‘‘rigidité’’, comme ce à quoi il doivent renoncer s’ils veulent démontrer leur capacité à s’adapter » (Isabelle Stengers, Une autre science est possibles ! Manifeste pour un ralentissement des sciences, La Découverte, Paris, 2013, p. 51-52).
xxiii Le documentaire Un monde pour soi de Yann Sinic et Nathalie Combe, 2008, édité en Dvd chez L’Harmattan (2008) donne à voir, par des images aériennes de lotissements du sud de la France, ces paradis privés où chaque maison, chaque jardin est construit comme un monde clos sur lui-même. Le documentaire donne aussi à entendre les désillusions de certains des nouveaux propriétaires pour qui ce rêve individuel se transforme en cauchemar d’isolement et de solitude.
xxiv Il y aurait beaucoup à dire et à écrire sur le niveau de respect et les qualités d’écoute qui à la fois œuvrent aux développement des pratiques des communs et en sont à la fois le résultat : habitude prise de discuter collectivement, apprentissage de la prise en compte de la parole d’autrui et du décentrement de soi, manière de se nourrir des opinions divergentes avant de consolider la sienne propre, etc. Cela n’empêche ni les conflits, ni les blocages, ne les dérapages, mais vient les limiter et les sortir des enjeux purement individuels. Guillaume Sabin, dans L’Archipel des Égaux…, op. cit., a essayé de rendre compte de cette qualité de délibération dans des chapitres d’entretiens collectifs de communautés autochtones argentines luttant pour la sauvegarde et le renforcement du travail des communs dans leurs communautés.
xxv Les familistères de Guise (France) et de Laeken (Belgique) sont des coopératives d’habitat conçues au XIXe siècle par l’industriel Jean-Baptiste André Godin pour loger les ouvriers de ses usines, sur le modèle collectiviste et à vocation émancipatrice du phalanstère du philosophe socialiste Charles Fourier (Marion Segaud, Jacques Brun, Jean-Claude Driant, Dictionnaire de l’habitat et du logement, Armand Colin, Paris, 2002). Le mouvement des Castors renvoie à l’organisation de familles ouvrières qui, en période de carence de logement des années d’après-guerre et jusqu’aux construction en masse des logements sociaux dans les années 1960, auto-construisent collectivement leurs logements (id.). Le mouvement pour un habitat groupé autogéré (Mhga) des années 1970 et 1980, puis le mouvement de l’habitat participatif à partir des années 2000 regroupent des projets d’habitat définis par la participation voire l’autogestion des habitants lors de la constitution du projet immobilier puis lors de la gestion de l’habitat en commun (Pierre Lefèvre, L’habitat participatif. 40 ans d’habitat participatif en France, Éditions Apogée, 2014).
xxvi En opposition au concept d’autonomie et en distinction du concept d’aliénation, André Gorz propose le concept d’hétéronomie pour parler de la dépossession de soi qui résulte de l’emprise dans des « mégamachines » sociales. Selon lui, « L’hétéronomie du travail ne résulte pas seulement de son organisation et de sa division capitalistes. Elle résulte plus fondamentalement de la division et de l’organisation de la production à l’échelle de grands espaces économiques, de sa mécanisation et de sa cybernation. […] [Elle] est une conséquence inévitable de la socialisation du processus de production qui, elle-même, est rendue nécessaire par la masse et la diversité des savoirs incorporés dans les produits »» (Gorz, Les chemins du paradis, Galilée, Paris, 1983, p. 104).
xxvii Ce travail des communs qui consiste à ne pas se laisser déposséder, qui consiste au contraire à se réapproprier et les choses et les manières de faire est bien mis en évidence par Pierre Dardot et Christian Laval (Commun.., op. cit., p. 445-451) et par Pascal Nicolas-Le Strat (Le travail du commun, op. cit., p. 29-30). Elinor Ostrom qui s’intéresse peu à l’organisation politique fait pourtant sans cesse référence à des organisation de type self-government quand elles relatent des expériences de communs (Gouvernance des biens communs…, op. cit., p. 77-112). Pour Franco Ingrassia les processus d’auto-organisation sont des processus qui construisent du lien social dans un contexte mercantile qui tend à sans cesse le détruire, ce qui signifie que pour que ces liens perdurent les processus d’auto-organisation doivent être menés de manière continue, en cela ils constituent des modes de vie (La Socialidad, Hekht Libros, Buenos Aires, 2014, p. 60-61 et 64).
xxviii Il faudrait se questionner sur le fait que de nombreuses expériences des communs dans le monde occidental s’empare des pratiques de consommation (Amap, supermarchés coopératifs, habitat…), signe que quelque chose se passe et qui va à l’encontre du constat d’André Gorz sur des modes de consommations qui entérineraient la séparation du privé et de la politique, cette dernière étant laissée à l’État, devenu le gestionnaire exclusif de l’organisation de la vie sociale (Métamorphose du travail, Critique de la raison économique, Folio essais, Paris, 1988). Via ces expériences, les modes de consommations sont repolitisés. Mais cet état de fait ne laisse-t-il pas le travail des communs à celles et ceux qui sont en mesure de consommer, d’acheter un logement, de manger bio, etc. ? S’emparer des modes de production ne dessine-t-il pas un travail des communs moins soumis à cette distinction de classe ? C’est en tout cas le mode privilégié de développement des communs dans les pays du Sud (coopératives de tout type, gestion des ressources foncières, hydriques, agricoles ou forestières), et ce aussi bien en milieu rural qu’urbain, y compris dans les plus grandes métropoles mondiales comme en témoignent les usines récupérées ou « usines sans patron » de Buenos Aires (Colectivo Lavaca, Sin Patrón, Fábricas y empresas recuperadas por sus trabajadores, Lavaca Editora, Buenos Aires, 2007, et en langue française : Andrés Ruggeri, ‘‘Occuper, résister, produire’’ : autogestion ouvrière et entreprises récupérées en Argentine, Éditions Syllepses, Paris, 2015). Ce constat n’a aucune portée judicative : il vient dire un état de fait, et aussi sans doute quelque chose de plus sur l’ampleur du régime culturel de privatisation selon l’endroit où l’on se trouve sur la planète, et donc sur les marges de résistance et les brèches, ici et là, permettant de reconquérir des espaces où se développe le travail des communs.
xxix Sur la lutte de l’eau à Cochabamba, Bolivie, menée à partir de l’année 2000, et son caractère radicalement anti-privatisation et relevant d’un travail des communs : Franck Poupeau, « La guerre de l’eau : Cochabamba, Bolivie, 1999-2001 », Agone , n°26-27, 2002, p. 133-140 et Walter Chávez, « Effervescence populaire en Bolivie », Le Monde Diplomatique, mars 2005.
xxx Le journaliste et sociologue uruguayen Raúl Zibechi a consacré un livre, traduit en français, sur l’expérience de la ville de El Alto : Disperser le pouvoir : les mouvements comme pouvoirs anti-Étatiques – Soulèvements et organisation à El Alto (Bolivie, 2003), L’Esprit frappeur, Paris, 2009.
xxxi Sur la difficulté des espaces surdéterminés à produire de l’émancipation, nous renvoyons à l’article de Guillaume Sabin « Pédagogies à visées émancipatrices : entre militantisme et dominations, la question des normes » paru dans l’ouvrage coordonné par Nassira Hedjerassi, Les pédagogies émancipatrices : actualités et enjeux, Éditions du Croquant, Vulaines-sur-Seine, 2020, p. 87-115.
xxxii Jacques Rancière a fait de cette question de l’indétermination et de la désidentification comme condition du politique et de l’émancipation un fil directeur de son travail, on en trouvera trace par exemple dans les ouvrages suivant : Et tant pis pour les gens fatigués, Éditions Amsterdam, Paris, 2009, p. 653 et sq. ; Le Spectateur émancipé, La Fabrique éditions, Paris, 2008, p. 72-75 ; Aux bords du politique, Gallimard, Folio Essai, Paris, 1998, p. 212-213.
xxxiii Isabelle Stengers reprend l’expression matter of concern développée par Bruno Latour pour parler d’espaces communs ou naissent d’autres manières de faire, centrées autour d’enjeux communs où « ceux qui sont concernés le soient effectivement, soient pleinement habilités à participer à ces espaces de délibération » (« Ralentir les sciences, c’est réveiller le chercheur somnambule », p. 71, entretien avec Isabelle Stengers réalisé par Estelle Deléage, revue Écologie & Politique, n°48, p. 61-74, 2014).
xxxiv Dans le livre de recueil d’expériences politiques et de travail des communs Constellations, Trajectoires révolutionnaires du jeune 21ème siècle, un collectif belge se demande : « Quel est notre rapport à l’ennemi, sachant qu’il ne nous fait pas face mais qu’il nous traverse ? […] Il nous fallait quitter la critique perpétuelle […], chercher une nouvelle finesse politique. L’abandon du sujet critique nous a obligé à penser autrement ce qu’est l’action politique, la camaraderie, comment on pouvait penser les choses non plus en termes de conscience mais de contagion » (Collectif Mauvaise Troupe, L’Éclat / Poche, Paris, 2014, p. 95).
xxxv Le livre de Pierre Dardot et Christian Laval, Commun, Essai sur la révolution au XXIe siècle, op. cit., se termine par l’invitation à penser l’expansion des communs au-delà d’une diffusion « par le bas » et de « proche en proche » (p. 546).