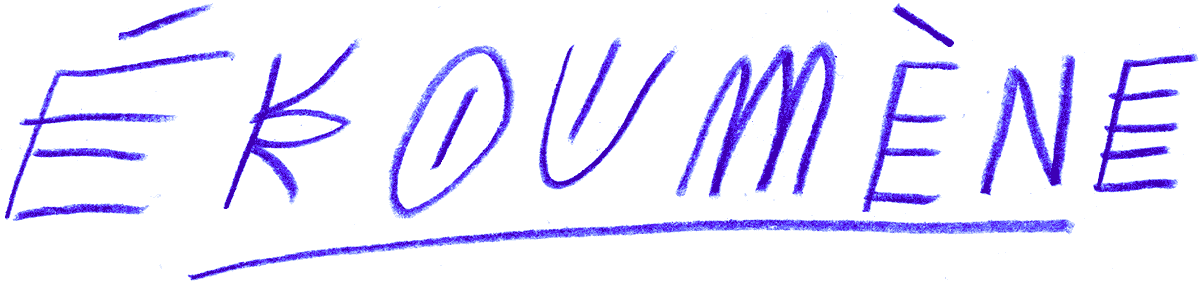Réflexions sur le travail de mise en commun de l’habitat – adressées à celles et ceux qui participent à un projet d’habitat participatif
Pierre Servain
sociologue à l’université de Brest, habitant d’Ékoumène (habitat participatif à Brest)
Mars 2023
pierre.servain@laposte.net
Ce texte fait suite à une enquête sociologique menée auprès d’habitats participatifs et aux diverses communications et échanges qui l’ont prolongés. Il n’en est pas une synthèse, mais plutôt une présentation des réflexions qui paraissent le plus utiles aux personnes qui veulent participer de près ou de loin à des projets d’habitats participatifs. Étant donné cette intention, j’ai essayé d’écrire dans une forme qui ne rebute pas trop les non-universitaires, tout en maintenant une attention à bien expliciter le propos. Pour une présentation plus approfondie et rigoureuse, je renvoie les lecteurs au livre Faire de l’habitat un commun. Les habitats participatifs de l’ouest de la France, publié en 2023 aux éditions des Presses universitaires de Rennes, et à mes autres textes – la plupart sont disponibles sur internet, et je peux les envoyer sur demande.
Une démarche minoritaire qui suscite de l’intérêt
L’habitat participatif ne se réduit pas à un type d’architecture ou de statuts juridiques : c’est une démarche. Celle-ci est minoritaire, et se développe (chacun pourra insister sur un aspect ou l’autre de la phrase). Sur son site internet, l’association Habitat Participatif France recense des dizaines d’habitats construits (certains depuis les années 1970) et des centaines de projets en cours. Ce nombre augmente constamment, surtout depuis 2010 (premières Rencontres nationales de l’habitat participatif) et 2014 (loi Alur), années qui marquent l’entrée de la participation de la politique publique dans le développement de la démarche, et qui lui donnent son nom officiel. Pour autant, son intérêt dépasse le seul nombre de projets d’habitat, ce que montre bien l’attention qu’y porte le grand public, les médias, la politique publique, et la recherche. C’est que la démarche renvoie à des idéaux largement partagés : « se réapproprier notre habitat », « vivre ensemble, chacun chez soi », et faire de l’habitat une « démarche citoyenne ».
La suite du texte présente la démarche de l’habitat participatif comme un ensemble. Pour autant, il est bien entendu que chaque habitat a ses propres singularités. Il convient en particulier de distinguer trois types de projet en fonction de leurs rapports aux institutions (collectivités territoriales et bailleurs). Des projets « descendants » sont à l’initiative des institutions. Des projets « ascendants » sont à l’initiative d’habitants qui sollicitent des institutions, non seulement pour demander un soutien pour leur propre projet mais aussi pour impulser un changement dans la politique publique. C’est dans ce type de projets que se trouvent le plus d’habitants investis dans le « mouvement de l’habitat participatif », constitué d’associations, de structures professionnelles d’accompagnement, et d’autres professionnels de l’habitat, et qui organise notamment des rencontres régionales et nationales. Des projets « horizontaux » ne recherchent pas particulièrement de partenariats avec des institutions. Depuis la participation des institutions à la démarche, les projets descendants sont aujourd’hui les plus nombreux à se monter. Pour autant, ce sont les projets qui se reconnaissent le moins dans les propos qui vont suivre : de fait, les projets descendants se trouvent dans une zone poreuse entre les projets qui s’engagent pleinement dans les principes qui constituent la singularité des habitats participatifs et les habitats plus ordinaires.
Une définition : des habitats groupés et participatifs
L’habitat participatif est, comme son nom l’indique, participatif. Ce terme renvoie à deux principes. Premièrement, l’idée que les habitants prennent une part plus importante que la moyenne à la construction et à la gestion de leur habitat, cela en collaboration avec les professionnels de l’habitat, voire à leur place. La participation est très différente d’un projet à l’autre, tant dans ses secteurs d’activité (promotion immobilière, architecture, maîtrise d’œuvre, construction, entretien…) que dans ses degrés (information, consultation, concertation, cogestion, voire autogestion).
Deuxièmement, l’habitat est « participatif » au sens où il est attendu que les projets participent au bien commun : les habitats visent l’écologie, l’anti-spéculation, l’animation sociale locale, la mixité sociale et/ou générationnelle. Aucun groupe ne vise chacun de ces principes à égalité (ce serait d’ailleurs impossible), mais tous en visent au moins un, en plus d’un principe qui se retrouve toujours, celui de la convivialité entre voisins. Quant aux habitants, il est attendu qu’ils participent activement au projet.
L’habitat participatif est aussi un habitat groupé. Ce terme renvoie lui aussi à deux principes.
Premièrement, ce sont les habitants qui se regroupent. Le groupe est d’abord un moyen de porter un projet, celui de construire « un habitat à notre image », et non un habitat conçu sans leur participation. Mais le groupe n’est pas seulement un moyen, c’est aussi une visée. L’idée d’un habitat groupé se comprend à l’opposé des habitats individuels ordinaires, jugés (à tort ou à raison) isolés et isolants, chacun chez soi. Dans le même temps, l’idée se comprend en distinction des habitats partagés (colocations…) : chaque ménage y dispose de son propre logement autonome. Les habitats groupés ne sont pas non plus des habitats communautaires (et encore moins des résidences collectives de type Ephad, en ce qui concerne les habitats participatifs pour personnes âgées), qui sont jugés (à tort ou à raison) refermés en enfermant, où personne ne se sent chez soi. Entre ces types d’habitat, jugés trop individualistes ou trop collectivistes, le type de regroupement des habitats participatifs vise un « juste milieu » (en réalité toujours discutable) qui permettrait de constituer les bonnes conditions pour mieux s’approprier son habitat et générer de la rencontre.
Cela crée des liens particuliers entre habitants, qui tiennent à la fois, mais jamais uniquement ni complètement, des relations de voisinage, de cohabitation, de famille, d’amis, de collaborateurs partageant un projet commun… « Il faudrait inventer un mot pour ça ! », s’amuse un habitant. Je propose pour ma part le terme de « voisins-cohabitants ». Le terme a le désavantage de laisser de côté les degrés de proximité affective (très divers au demeurant) qui lient les habitant, mais il rend bien compte d’une dynamique particulière des habitats participatifs. Les habitats participatifs constituent une cellule domestique inhabituelle, le groupe habitant qui, en tant que tel, habite les lieux (en particulier les espaces communs), les gère et les entretient ; mais cette cellule domestique ne supplante pas celles des foyers : les deux types de cellules domestiques (groupe et ménages) coexistent. De ce fait, les habitants passent tour à tour des rapports de cohabitat (vivre sous dans un même habitat), où prime le groupe habitant et ses règles communes, aux rapport de voisinage (vivre dans des habitats voisins), plus distants. Cette dynamique crée de l’incertitude qui peut être déroutante, mais c’est aussi ce qui fait la souplesse et la richesse des rapports entre habitants.
Deuxièmement, ce sont les habitats qui se regroupent. Les habitats comprennent une part importante d’espaces communs et de matériel mis en commun. Ceux-ci peuvent se diviser en deux catégories : les communs utilitaires et les communs de rencontre. Les mises en commun utilitaires se comprennent dans une logique d’économie et d’optimisation. Typiquement, c’est la chambre d’amis ou la buanderie mises en commun (avec tout leur équipement) pour éviter d’avoir à les reproduire dans chacun des logements. La logique de la mise en commun d’espaces de rencontre est toute autre : il ne s’agit pas d’économie mais plutôt de construire des espaces en plus (avec leurs équipements). Il s’agit typiquement des salles communes, dans lesquelles on fait des fêtes, des réunions ou des événements publics. Non seulement ces espaces et équipements ne pourraient pas voir le jour sans la démarche du regroupement, mais ils n’auraient pas de sens : ces espaces et équipements sont des supports qui incarnent le projet collectif. Je précise que des espaces utilitaires peuvent devenir des espaces de rencontres, à l’image des halls d’entrée et des paliers qui sont volontairement agrandis pour qu’ils deviennent confortables et habitables. Il est important de distinguer les espaces (et matériel) de rencontre des utilitaires : alors que les institutions et promoteurs valorisent les deuxièmes (qui permettent des économies substantielles sous le deal « moins d’espace privé en échange de plus d’échange commun »), elles rejettent généralement les premières en les qualifiant de « surcoûts » (souvent sans même prendre le temps d’en estimer les coûts). Ce sont pourtant les espaces communs de rencontre qui portent le plus le projet collectif.
Faire de l’habitat un projet de mise en commun
L’habitat participatif consiste à faire de l’habitat un projet. Le terme est à comprendre dans toute sa portée, et pas seulement comme quelque chose qu’on compte faire à l’avenir (comme des projets de vacances, par exemples). Monter un projet d’habitat participatif renvoie à l’idée de faire de l’habitat quelque chose qui n’est pas seulement un habitat, mais aussi le support de réalisation de principes moraux et politiques, en termes d’écologie, d’anti-spéculation, d’animation sociale locale, de mixité sociale et/ou générationnelle, de convivialité et de rencontre. Dans ce sens, les habitats continuent d’être des « projets » même quand les bâtiments sont construits et qu’on les habite. C’est au nom de tels principes de bien commun que ces habitats dépassent le stade de l’action privée et justifient la mobilisation de tiers, notamment des politiques publiques. Par ailleurs, ce sont des projets qui engagent profondément et durablement non seulement les groupes mais aussi les individus. L’expression « projet de vie » s’entend souvent. Des questions souvent posées aux habitants des habitats participatifs permettent de bien situer le propos : « Tout se passe bien chez vous ? Vous ne vous étripez pas ? Vous êtes bien intégrés dans votre quartier ? » Ce type de questions ne s’entendent pas si souvent que cela dans le cadre d’habitats ordinaires (entendu dans le sens d’habitats qui, justement, ne se constituent pas particulièrement comme des projets). Ces questions laissent entendre que les principes visés, en plus d’être des principes normatifs (qui définissent ce qui doit être) sont aussi des principes d’évaluation : par définition, les projets exposent au jugement critique. Il convient de noter que ces principes évaluateurs ne sont pas seulement ceux formulés par les habitants : ce sont aussi ceux qui sont attendus, à tort ou à raison, par tout autre acteur (des voisins, des amis, des collectivités territoriales…), qui attendent de tout habitat participatif qu’il soit écologique, socialement mixte, et tous les principes indiqués plus haut. La critique, l’auto-critique et le travail de l’image font partie intégrante des projets.
Les projets d’habitat participatif prennent la forme d’une mise en commun de l’habitat. Cela porte à conséquence, car ils se confrontent à la norme dominante dans l’habitat occidental qui vise au contraire, et ce depuis des siècles, à réduire au maximum la part du commun. Cette norme se retrouve quand des personnes ne comprennent pas l’intérêt de la démarche, et qu’ils jugent même qu’elle est dangereuse, une atteinte à l’autonomie privée, en même temps qu’un risque d’entre-soi qui relèverait du communautarisme. La norme dominante se trouve aussi dans les normes de construction de logements et dans les règles de propriété, quand il s’agit de convaincre des notaires ou des banquiers que le régime de la copropriété classique n’est pas le meilleur cadre pour créer de la gestion commune, ou quand les agents de viabilisation (eau, électricité, gaz) ne savent pas comment répondre à des clients qui ne reconnaissent ni dans la case « logement individuel » ni dans celle du « logement collectif destiné à la revente ». La norme dominante se retrouve enfin dans l’architecture habituelle des espaces : la part des équipements communs (les derniers restant étant historiquement les espaces liés à la gestion de l’eau) sont progressivement privatisés, les communs étant jugés les lieux de discorde et de désordre. Tout l’habitat moderne consiste à réduire le commun au profit d’un côté du privé, qui concentre toute l’attention de l’habitat où l’on se sent chez soi, et de l’autre le public, espace laissé à la responsabilité de la puissance publique. Entre-deux ne subsiste plus que des espaces dits « intermédiaires » ou « entre-deux », c’est-à-dire des espaces seuils qui jouent la fonction de tampon entre le privé et le public : des halls d’entrée, des couloirs, des paliers, des cours… En plus d’être réduits au maximum, ces espaces sont neutralisés : il ne doivent pas être trop décorés, appropriés, confortables, y séjourner durablement est illégitime. Le pari de la mise en commun de l’habitat dans les habitats participatifs se constitue à l’opposé de cette posture. Non seulement les espaces communs prennent une plus grande part des surfaces, mais en plus ils sont habités et investis par les habitants. Ce ne sont pas des espaces « entre-deux », mais des espaces qui prennent leur sens en soi. On y trouve des chaises, des fauteuils, des tables, des étagères pleines de livres, des décorations, éventuellement des enfants qui jouent ou des adultes qui discutent. Les espaces communs peuvent être troublants car ils sont inhabituels : quand on y est, on n’est pas dans l’espace privé d’un ménage en particulier, mais on est déjà chez quelqu’un : on est chez le groupe habitant, avec toute son identité qui s’affiche.
Au final, la démarche de l’habitat participatif relève d’une forme de travail : cela ne se fait pas tout seul, ni sans rencontrer des problèmes, des résistances, et cela produit des effets. Le travail s’appuie sur des supports : des architectures, des organisations de discussions, des rituels, des récits collectifs, des rapports affectifs… Ces supports ne viennent pas de nulle part : il faut les constituer, les entretenir, les ajuster. Et cela, c’est aussi du travail. La participation à ce travail peut être explicite, mais il est le plus souvent tacite, dans l’esprit « ce n’est pas obligatoire, mais c’est attendu ». Typiquement, les groupes obligent rarement à participer à toutes les réunions, mais ils considèrent que c’est un problème quand les réunions ne mobilisent plus personne. De même, on ne peut pas obliger un habitant à participer aux fêtes et autres événements collectifs, ni à se montrer particulièrement convivial avec les voisins, mais on peut se demander si un habitant non-participant est bien à sa place dans un tel projet qui suppose qu’on dépasse l’habitat chacun chez soi.
Le travail sur lequel repose l’habitat participatif est collectif, il est aussi individuel : les habitants mobilisent leurs capacités. Ils en sont parfois bousculés, ne serait-ce que sur ses représentations des délimitations entre ce qui relève du domaine du privé et de ce qui relève du domaine de ce qui se discute. Être bousculé n’est pas un mal en soi, et c’est même recherché, c’est le propre de toute expérience engageante. Le tout est d’en sortir agrandi plutôt que fragilisé. On me demande souvent si on habite mieux dans un habitat participatif. Je réponds que c’est l’objectif, mais que ce n’est pas une garantie. Certains vivent mal l’expérience : ils se sentent jugés, envahis, contraints. D’autres, la grande majorité, se sentent au contraire libérés, agrandis, plus disponibles. Je précise aussi que les habitats participatifs connaissent eux aussi leurs désaccords et leurs conflits. Je ne pense pas qu’il y en ait ni plus ni moins que dans les habitats ordinaires. Mais la différence tient en deux points : premièrement, les enjeux y sont tendanciellement plus grands, car les habitants s’y engagent plus fortement. Deuxièmement, les habitats participatifs disposent de davantage de supports pour prévenir et réguler de tels désaccords et désajustements. En un mot, l’habitat participatif ne garantie pas le succès de la démarche, mais il met en place des supports pour y travailler.
Des questions récurrentes et des conseils
Les rencontres avec divers groupes en projet montrent que certaines questions reviennent avec récurrence. Je me permets ici de donner quelques avis et conseils.
Une première question renvoie au choix des statuts juridiques (copropriétés, coopérative, société civile immobilière, société civile de construction…). Un premier réflexe est de se renseigner sur les avantages et inconvénients de chacun de ces statuts. Mais ce travail devient vite fastidieux et pour tout dire assez inutile (à moins de vouloir devenir un expert des statuts juridiques existants). Mon conseil est de renverser le questionnement, et de commencer à se demander quelles sont les volontés, ou pour mieux dire les priorités du groupe. C’est en partant de là qu’un groupe pourra le mieux choisir ses statuts, en éliminant certains (par exemple, le statut de la copropriété paraît le plus indiqué pour bénéficier des aides au logement, mais il exclut l’objectif de l’anti-spéculation), et en voyant comment les travailler, les ajuster, pour qu’ils deviennent un support au projet au lieu d’être un frein. La remarque n’est pas seulement valable pour les statuts juridiques : les groupes débutants ont souvent tendance à mettre une multiplicité d’objectifs au même niveau (écologique, anti-spéculatif, avec une mixité sociale et générationnelle…). En réalité, ils n’arrivent à avancer concrètement que quand ils priorisent leurs objectifs, et acceptent l’idée qu’on ne peut pas jouer à égalité sur tous les fronts. Monter un projet signifie faire des choix, des arbitrages, et donc des compromis. Aller jusqu’au bout de la logique signifie s’accorder sur les principes auxquels on tient coûte que coûte, quitte à renoncer à d’autres objectifs qui paraissent secondaires. C’est à cette condition que la discussion se concrétise, qu’on met à l’épreuve les désirs et les limites (qui peuvent évoluer en cours de route, soit dit en passant). Cette remarque est valable pour le choix des objectifs politiques, mais aussi pour des questions d’habitat qui peuvent se révéler fondamentales sur le plan collectif et/ou personnel : localisation, grand jardin ou pas, présence d’animaux ou pas…
Une autre controverse récurrente est celle de la nécessité ou non d’écrire une charte. « Sans charte, vous êtes fichus », disent plusieurs groupes. Je ne partage pas cet avis. Plus exactement, je pense qu’on se trompe souvent sur la fonction d’une charte. Si on attend d’une charte qu’elle permette d’anticiper des conflits et de les réguler, alors on se trompe lourdement. De telles régulations sont nécessaires, c’est entendu, mais une charte n’est pas un outil adapté pour cela. Il ne sert à rien de rappeler que la charte prône la tolérance et l’ouverture pour résoudre quelque problème que ce soit. Mettre sur un papier des valeurs consensuelles ne dit en rien comment elles sont mises à l’épreuve du concret, et comment on réagit quand elles ne sont pas respectées. Par contre, l’élaboration d’une charte peut jouer une autre fonction, très importante elle aussi : celle du récit de la fondation, celle de la symbolisation du pacte commun. Cette fonction-là est nécessaire dans tout projet collectif, car tout projet collectif doit constituer son propre récit. Mais cette fonction peut être remplie par d’autres moyens qu’une charte : certains groupes retiennent la date de leur première réunion, de la visite d’autres habitats, de l’achat du terrain ou d’autres événements, et la rédaction de compte-rendus, de dossiers ou d’autres documents. « Ce ne sont pas des valeurs qui nous regroupent, c’est des pratiques », disent des habitants peu convaincus par l’utilité des chartes. Sans doute la charte est-elle une forme qui n’a de réelle importance que pour les groupes d’origines disparates qui cherchent à se constituer autour d’un texte commun : l’élaboration de la charte est alors l’une de leurs premières pratiques communes. Quitte, comme le font certains groupes, à ne jamais la consulter par la suite.
Une autre controverse concerne la nécessité ou non de disposer d’espaces communs. La question se pose pour les espaces communs utilitaires et plus encore pour les espaces communs de rencontre. La question se pose surtout quand il s’agit de faire des arbitrages financiers : les espaces communs deviennent alors l’une des principales variables d’ajustement. Mais pour certains, la question n’a pas à être débattue : « la salle commune, c’est le centre du projet ». En réponse à cette question, j’ai en tête le cas d’un habitat participatif qui ne dispose pas d’un tel espace et dont l’activité relève pourtant bien d’un habitat participatif très dynamique. Cela semble donner raison à ceux qui disent que de tels espaces communs de rencontre ne sont pas nécessaires aux habitats participatifs. Mais il faut aussi préciser que ce groupe mobilise beaucoup d’autres supports pour leur projet : ils organisent régulièrement des activités culturelles ouvertes au public, ils ouvrent à ces occasions leurs appartements privés, ils font tous plus ou moins partie du milieu des événements culturels, ils partagent très régulièrement des repas, partent en vacance ensemble, ils se connaissent depuis longtemps, bien avant d’emménager dans leur habitat participatif. Bref, est-ce que les espaces communs sont nécessaires aux démarches que sont les habitats participatifs ? Non, sans doute, mais ils en sont tout de même un support privilégié. Non seulement ils en sont un levier (on y fait des réunions, des fêtes, des événements…), mais en plus ils en sont une sorte de symbole commun, un ralliement : ils incarnent les possibles du projet collectif. Le manque d’un tel support suppose de pouvoir être compensé par une multiplicité d’autres supports.
Autre controverse : doit-on obliger à la participation ? L’idéal est que tout le monde veuille participer, bien sûr. Mais que fait-on quand on constate que ce n’est pas le cas, que celles et ceux qui participent en réunion sont trop peu nombreux pour se sentir légitimes pour prendre quelque décision que ce soit, ou que certains habitants ne participent manifestement plus aux activités collectives ? Certains groupes se montrent volontiers contraignants dans ces cas-là, jugeant que sans participation collective, c’est le projet qui meure. D’autres groupes donnent plus de latitudes aux désirs et non-désirs de chacun, mais cette stratégie risque de faire mourir le projet rapidement ou à petit feu. Ici, mon conseil n’est que partiel, et se reporte sur la régularité des réunions formelles : il vaut mieux ne pas attendre d’avoir quelque chose à se dire pour se réunir. Il vaut mieux maintenir des réunions régulières en se disant qu’au pire, si on n’a rien à se dire, on prendra l’apéro. En effet, il est plus facile d’ajouter un point sur un ordre de jour au cours d’une réunion déjà prévue que de mobiliser tout le monde pour constituer une réunion spécifique. C’est bien souvent par ce moyen que surgissent les propositions les plus inattendues. Le conseil peut se résumer par ce slogan « ce n’est pas parce qu’on a des choses à se dire qu’on se réunit, c’est parce qu’on se réunit qu’on a des choses à se dire ». La formule est vraie sur un registre politique, elle l’est aussi sur un registre affectif – de fait, les deux registres sont très poreux dans un projet tel qu’un habitat participatif. D’ailleurs, un autre conseil est de mêler l’affectif au purement organisationnel, et l’informel au formel, par exemple en mangeant ensemble après une réunion. Autre conseil sur le même registre : le projet global devant se réactiver sans cesse, il est important de l’incarner dans de multiples petits projets mobilisants, que ce soit de l’entretien collectif, des fêtes et des convivialités entre soi, ou des événements qui accueillent du public extérieur. En effet, la participation à l’informel est au moins aussi importante que la participation au formel.
Dernière controverse enfin, celle de la maîtrise ou non du choix des nouveaux habitants. Cette question clive d’un côté ceux qui pensent que le projet ne peut tenir que par l’adhésion des membres et donc par leur cooptation, et de l’autre côté ceux qui pensent que choisir ses voisins relèvent d’une forme d’intrusion intolérable, totalitaire et anti-citoyenne, génératrice d’entre-soi, et par ailleurs illégale au vu de la loi. Un accompagnateur a eu le bon mot de dire que l’idée de la cooptation n’est pas tant de choisir ses voisins que de choisir son mode de voisinage. La formule est bonne, même si le sociologue que je suis ne peut pas s’empêcher que la disposition à adopter des modes de voisinage singuliers recoupent de fait des populations aux expériences de socialisations similaires. À cette question, certains groupes choisissent l’option de demander aux futurs habitants postulants de se présenter, ce qui peut aller jusqu’à écrire des lettres de motivation et autres épreuves de présentation de soi. D’autres pensent que de telles procédures sont inutiles car les nouveaux arrivants n’arrivent de toute façon jamais par hasard. Je ne crois ni à l’une ni à l’autre formule. Non seulement la première paraît éthiquement dérangeante, mais en plus elle n’est pas très efficace : on évalue davantage la capacité d’une personne (ou d’un ménage) à bien se présenter que sa future participation au projet. La deuxième formule n’est pas meilleure : j’en veux pour preuve le nombre d’habitants ayant choisi leur logement pour son grand jardin et ses équipements accessibles sans bien comprendre quelle participation était attendu d’eux. Je conseille une troisième posture : donner aux futurs habitants les moyens de comprendre à quoi ils s’engagent, et si cela leur convient. Cela ne passe pas seulement par la lecture d’une charte, c’est aussi partager concrètement de l’activité avec les habitants. Ainsi, l’évaluation est réciproque. De plus, et c’est peut-être plus important encore, elle se porte moins sur les personnes que sur le projet lui-même. De tels événements sont l’occasion de questionner à la fois l’héritage (le passé) du projet et sa réactualisation (le devenir). Je précise par ailleurs que les arrivées de nouveaux habitants sont certes des événements parmi les plus marquants dans la vie d’un habitat participatif, mais ce sont pas les seuls : il y a aussi le départ des enfants devenus adultes (surtout quand les enfants des différents logements ont le même âge), et le vieillissement des habitants (quelle énergie reste-il ? que faire des logements devenus trop grands ?). Ces mutations, plus progressives, comptent elles aussi dans le sentiment d’évolution de la vitalité du projet. Pas de conseil ici : c’est juste une remarque.
Des tensions pragmatiques
Cette dernière partie concerne des questionnement pour lesquels je n’ai aucun conseil à donner : je me limite juste à remarquer qu’ils sont eux aussi récurrents. J’emprunte la notion de « tension pragmatique » à la sociologie pragmatique : il s’agit de situations dans lesquelles les personnes mettent en tension divers principes qui pourraient justifier leurs actions, mais qui arrivent à des résultats différents, voire opposés. Il ne s’agit donc pas ici de dire quelle est la bonne option, ni de définir où se trouve le juste milieu entre diverses polarités opposées : il s’agit juste de dire que ces questions se reposent toujours tant que l’activité perdure. Ces tensions pragmatiques ne se règlent pas dans un monde de pure théorie, elles se manifestent toujours dans des situations concrètes. Elles peuvent devenir des sujets de conflits si elles ne sont pas correctement régulées, de manière formelle ou informelle et continue.
Première tension pragmatique : l’opposition entre l’excès de distance et l’excès de proximité entre habitants, ou pour le dire de manière plus positive, la recherche de la bonne distance (ou de la bonne proximité). Cette tension se retrouve dans tout type de voisinage : l’excès de distance se reconnaît quand un voisin ne dit jamais bonjour, l’excès de proximité se retrouve quand le voisin se montre invasif. La ligne de tension se déplace dans le cas des habitats participatifs, car ce qui est jugé « normal » dans l’habitat ordinaire relève a priori d’une distance supérieure aux attentes convenues (explicitement ou tacitement) dans un habitat participatif : on ne se satisfait pas d’un simple « bonjour-bonsoir » poli, on attend davantage d’implication personnelle dans les relations réciproques et dans le projet commun. La ligne de partage entre la distance et la proximité recoupe le travail de délimitation entre le commun et le privé, et entre le domaine de ce qui se discute et le domaine de ce qui ne se discute pas (ce qu’on confond souvent avec la ligne de partage entre l’individuel et le collectif). Est-il attendu qu’on prenne l’apéro ensemble ? Qu’on discute régulièrement et longuement ? Qu’on se fête nos anniversaires ? Qu’on s’invite les uns chez les autres ? Qu’on se préviennent réciproquement quand on va assister à un événement culturel qui pourrait éventuellement intéresser un voisin ? Qu’on se sente autorisé à s’adresser aux enfants des autres comme un presque parent ?
Deuxième tension pragmatique : entre la recherche de la régulation formelle et la recherche de la spontanéité. Cette tension pragmatique, elle aussi, se reconnaît dès que des personnes vivent ensemble, mais elle est exacerbée quand des personnes disent vivre un projet commun, où l’on cherche à davantage discuter collectivement pour avoir plus de prise sur un cadre commun d’expérience. Dans ce cas, la régulation formelle prend nettement plus de place. Pourtant, trop de régulation formelle n’a pas que des avantages. Premièrement, cela peut être ennuyeux de se réunir trop souvent. Deuxièmement, cela peut donner le sentiment qu’on ne peut jamais prendre d’initiative sans l’accord formalisé du groupe. Plusieurs formulations de principes visent à réguler un juste milieu entre les deux polarités, par exemple ne chercher à établir une règle que quand il est manifeste qu’on se trouve face à un nouveau problème et que la situation a toutes les chances de se reproduire, ou l’idée qu’une personne peut se sentir autorisée à mener une initiative tant que son effet est réversible. Mais cela ne change pas que les personnes qui agissent ne mesurent pas toujours en quoi leurs actions pourraient ou non poser problème aux autres, ni dans quelle mesure leurs effets sont réversibles. Cela ne change pas non plus que certaines personnes se sentent toujours plus autorisées que d’autres pour faire quoi que ce soit. Il convient de préciser deux remarques. Premièrement, une règle n’est pas toujours une règle de contrainte, ce peut être une règle d’autorisation : nombre d’explicitation de règles consistent à s’autoriser à faire des choses qui sembleraient incongrues ailleurs. On confond souvent liberté et absence de contrainte. Pourtant, la liberté ne suppose pas seulement l’absence de contrainte, elle suppose d’abord de la capacité. Un oiseau ne peut pas voler s’il est en cage, c’est entendu, mais il ne peut pas non plus voler s’il n’a pas d’ailes, s’il ne sait pas s’en servir, et s’il n’a pas d’air pour s’appuyer dessus. La liberté, ce n’est pas le vide, c’est la capacité de s’appuyer sur des supports. Parmi ces supports, les règles se trouvent être aussi souvent des supports d’autorisation que des seules interdictions, et le manque de règles explicites peut se montrer tout aussi paralysant qu’une surdétermination de règles. Deuxièmement, ce n’est pas parce qu’on n’agit pas selon une règle explicite qu’on n’agit pas selon une règle : la majorité des actions sont guidées par des principes tacites voire inconscients, mais non moins agissants – à commencer par les multiples ressorts de la domination sociale (les hommes sur les femmes, les parents sur les enfants, les premiers habitants sur les nouveaux arrivés, les solidement insérés professionnellement sur les précaires, etc.). De manière contre-intuitive, un principe formulé de manière explicite est ainsi plus exposé au changement qu’un principe tacite, puisqu’il est rendu visible et discutable. Mais cela ne change pas que trop formaliser est vite étouffant.
Une troisième tension pragmatique oppose l’objectif de l’accessibilité et l’exigence du projet. L’exigence du projet demande à ce que les habitants se mobilisent activement pour réaliser leurs objectifs, que ce soit en termes d’écologie, de faire soi-même, ou autre. Les habitants mobilisent leurs ressources pour ce faire, à savoir leurs compétences, leurs réseaux, leurs capitaux dans tous les sens sociologiques du terme (capital économique, culturel, social, symbolique…). Bien entendu, ils peuvent acquérir certaines de ces ressources par l’expérience, mais cela ne change pas que les habitants n’arrivent pas comme des feuilles vierges dans leurs habitats, et que ces ressources sont inégalement réparties. Force est de constater que maintenir de telles exigences devient un processus de sélection qui privilégie ceux qui mobilisent le plus de ressources, et finalement ceux qui en disposent le plus. Ce constat amène des groupes à baisser leurs exigences pour ne laisser personne sur le carreau. Mais, et de manière logique, les projets deviennent alors plus ordinaires. Le principe est comparable à la démarche de mettre des produits bio dans des supermarchés : cela permet d’éviter d’avoir à demander aux consommateurs de prendre leur vélo pour passer la moitié de la journée à discuter avec des producteurs locaux dans leurs fermes ; la démarche est moins exigeante, moins contraignante, mais dans le même temps elle perd du sens et de la cohérence. Le juste milieu entre les deux démarche est affaire d’arbitrage. Cette tension pragmatique se retrouve au centre de la typologie des projets « horizontaux », « ascendants » et « descendant » : les derniers, soutenus par les institutions, répondent à l’objectif de développer la démarche de l’habitat participatif pour un public plus nombreux et plus divers. Mais cela se fait, mécaniquement, en allégeant le travail effectué par les habitants, voire en réduisant les espaces communs, en un mot en renonçant en partie au sens de la démarche elle-même. De fait, les habitats les plus accessibles sont aussi ceux qui disposent le moins d’appuis pour approfondir les objectifs des projets, et ce sont ceux qui se rapprochent le plus des habitats ordinaires.
Cette remarque se retrouve dès la phase de projet immobilier. À ce titre, une précision paraît nécessaire : c’est un malentendu que de croire (comme le font certains habitants mais plus encore des instituions) que la facilitation de l’accès au logement serait l’un des principes politiques de l’habitat participatif. Par définition, faire de l’habitat un projet rend la démarche plus compliquée que s’il ne s’agissait que d’un simple accès au logement. La démarche n’est pas moins chère, parce que tout ce qui donne sens au projet (l’écologie, l’originalité des bâtiments, le financement des espaces communs de rencontre) demande des investissements importants. Les habitats peuvent être de meilleure qualité pour le même prix, et ils peuvent être économiques à l’usage dans le temps, mais cela ne relève pas de l’accès au logement. Et, surtout, la démarche demande par définition du travail qui suppose de mobiliser de multiples compétences. Il existe différents moyens de rendre l’habitat participatif plus accessible, mais ce n’est pas le fait de rendre l’habitat plus groupé et plus participatif en tant que tel qui le rend plus accessible : c’est plutôt en le rendant moins groupé et moins participatif qu’on le rend plus accessible.
Une quatrième tension pragmatique concerne la recherche de formation d’un groupe et l’évitement de l’entre-soi. Cette tension prend plusieurs formes selon le sens que l’on donne à « l’entre-soi ». On regroupe généralement et confusément deux phénomène sous ce terme, comme si l’un entraînait l’autre, alors qu’ils se distinguent pourtant très clairement dans la réalité. Le premier sens de l’entre-soi renvoie à la similitude des participants. Dans ce sens, la tension renvoie d’une part à la tendance à se regrouper entre personnes qui se ressemblent (en termes de classes sociales, d’âges, de types de configurations familiale, d’engagements militants…) et, d’autre part, la recherche délibérée de mixité. De fait, faute de démarches volontaristes pour créer de la mixité, c’est le regroupement par similitudes qui prévaut. Des habitants s’en défendent en disant « ce qui nous regroupe, c’est notre projet », et non pas des catégories pré-existantes aux projets. Ils ont raison dans un sens, mais la sociologie nous dit bien comment et pourquoi les modes de socialisation différenciés disposent les personnes à agir, penser et juger, et que l’on se retrouve donc tendanciellement de manière spontanée avec des gens qui nous ressemblent dans nos activités, quoi que l’on en dise, tous autant que nous sommes. Je précise que cette observation ne s’applique ni plus ni moins dans l’habitat participatif que dans tout habitat ni toute activité. Si le reproche d’un tel entre-soi est plus souvent adressé aux habitats participatifs qu’aux habitats plus ordinaires (sans parler des habitats délibérément fermés et sélectifs), c’est qu’ils se construisent sous le registre du projet citoyen, et qu’on attend de tout projet citoyen, plus que de toute autre activité, qu’il respecte l’impératif de la mixité. Le problème est que cet objectif, tout justifié soit-il, fragilise la dynamique de construction du groupe. En effet, celle-ci se construit en réalité moins sur des accords explicites que sur des manières inconscientes d’agir, de penser et de juger, et en l’occurrence d’habiter et de porter un projet commun. En un mot, l’impératif de la mixité n’empêche pas la dynamique de groupe, elle peut être une richesse comme on le dit souvent, mais elle risque aussi de se montrer décevante et de fragiliser la dynamique de groupe, surtout quand elle s’impose de manière autoritaire et extérieure, par exemple en sélectionnant les participants selon les seuls critères de leur type de prêt bancaire pour accéder au logement. L’autre sens de « l’entre-soi » renvoie à la fermeture sur soi. Ce reproche-là est lui aussi souvent adressé aux groupes d’habitat participatif, ce qui relève d’un paradoxe pour des projets qui se constituent justement dans l’idée de générer de la rencontre. Mais il convient de préciser que ce reproche-là relève plus du fantasme (la réduction de tout regroupement au communautarisme) qu’autre chose. De fait, les habitats participatifs ont plutôt tendance à générer davantage de situations de rencontres que les habitats ordinaires, et ce sont tendanciellement les habitants qui sont se reconnaissent le plus en termes de groupes qui le font le plus.
Une dernière tension pragmatique, enfin, oppose d’un côté l’objectif de maintenir le caractère en-projet de l’habitat dans le temps, et de l’autre le principe du droit au repos. En effet, la démarche de l’habitat participatif relève d’un travail, dans le sens où elle ne se réalise pas toute seule ni sans effort. Ce travail est exigeant, éprouvant, et continu. C’est un véritable enjeu, qui n’a rien de l’évidence, que de maintenir le caractère en projet de l’habitat dans le temps. Par défaut de ce travail, l’habitat se banalise et devient plus ordinaire. Certains le font très rapidement : beaucoup d’habitats participatifs, en particuliers les projets descendants, se construisent en tant que projets tant qu’ils en sont à la phase de projet immobilier, et visent à devenir un habitat plus ordinaire avec éventuellement de bons rapports de voisinage dès que les habitant emménagent leurs logements. D’autres habitats restent en projet pendant des décennies. Il n’y a pas de secret de longévité, si ce n’est l’entretien des supports du projet, tant en termes de supports matériels (espaces, équipements) que communicationnels et organisationnels (réunions, discussions informelles) et inter-relationnels et symboliques (événements entre soi et ouverts au public, mise en récit du projet). Il semble aussi que la présence des enfants soit décisive pour le maintien d’une dynamique à travers les décennies – ce qui suppose des rotations d’habitants avec de jeunes enfants. Mais la tendance majoritaire est celle d’un affaiblissement progressif du caractère en-projet des habitats. Cela s’explique facilement : les projets vieillissent, tout comme les habitats et les habitants. L’enthousiasme et la force du désir peut s’amenuiser au cours des années. Et surtout : cet impératif du maintien du caractère en-projet se confronte au droit de se reposer chez soi, qui est tout de même l’une des dimensions principales de tout habitat. Il faut noter que, contrairement à ce qu’on croit souvent, il n’est pas rare qu’un ménage reste habiter dans un habitat participatif quand bien même il ne participe pas ou plus au projet collectif : ils n’habitent pas ou plus le projet, mais cela ne les empêchent pas de continuer à habiter leur logement. Quant à la tendance à l’affaiblissement progressif des projets, les groupes les assument plus ou moins bien selon les cas. C’est parfois objet de réaction volontariste pour réanimer le projet collectif, ou de controverse. C’est parfois simplement vécu comme un retour à la normale, à l’ordinaire, ce qui n’a rien d’infamant.
En guise de conclusion
J’espère avoir contribué par ces quelques lignes à donner à mieux comprendre ce à quoi engage la démarche de l’habitat participatif. Les termes de travail et d’épreuves reviennent souvent. J’espère que mon souci de ne pas être trop angélique ne se traduit pas par l’effet inverse de donner à penser que la montagne est trop haute ou trop risquée. J’ai surtout voulu mettre la lumière sur les questionnements qu’activent de telles expériences. Mon avis personnel est que de tels questionnements méritent d’être concrètement expérimentés, que ce soit dans le cadre d’un projet d’habitat participatif ou ailleurs. Et aussi qu’on gagnerait tous à davantage travailler nos manières d’habiter et à faire commun.